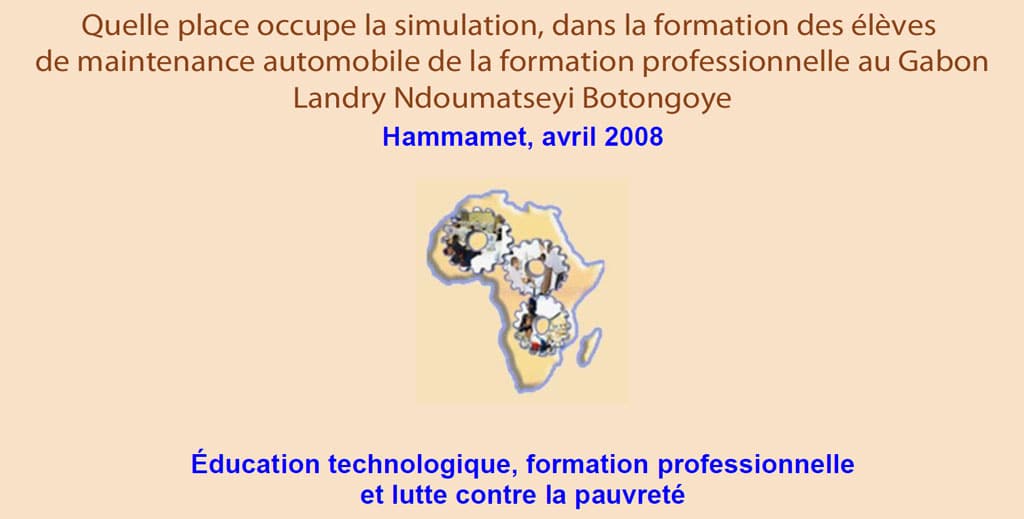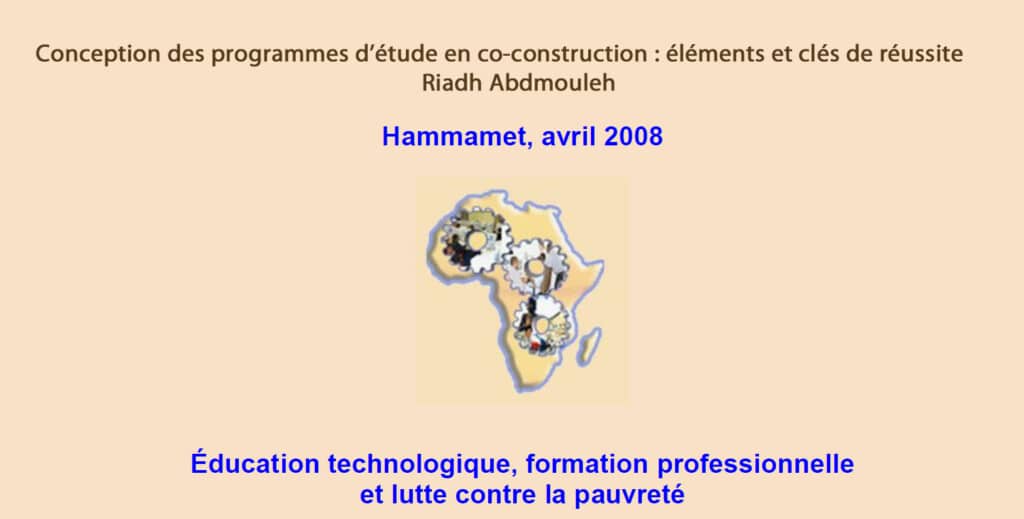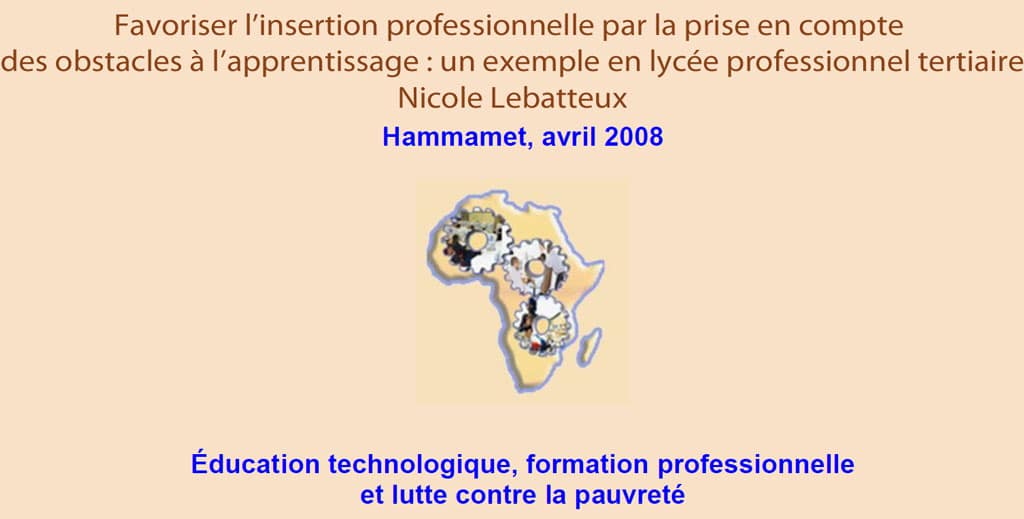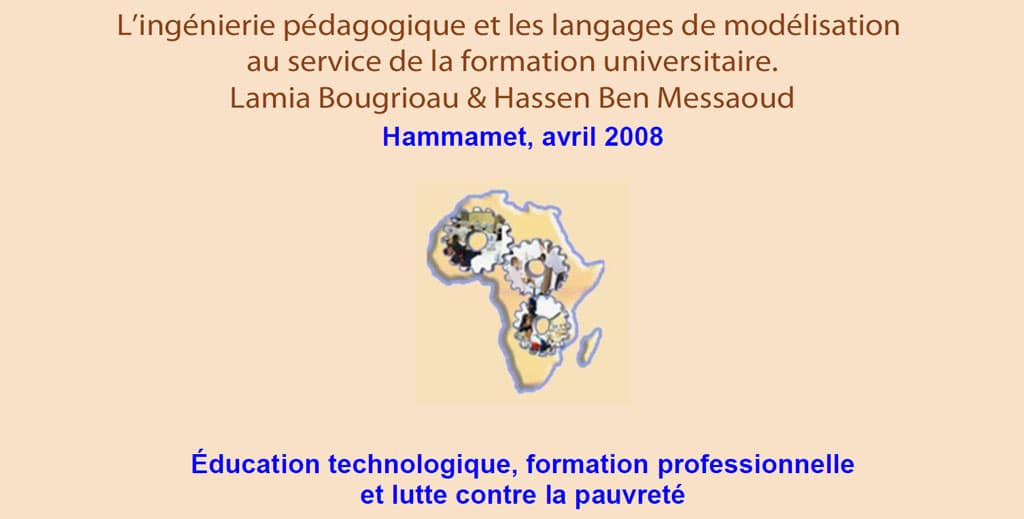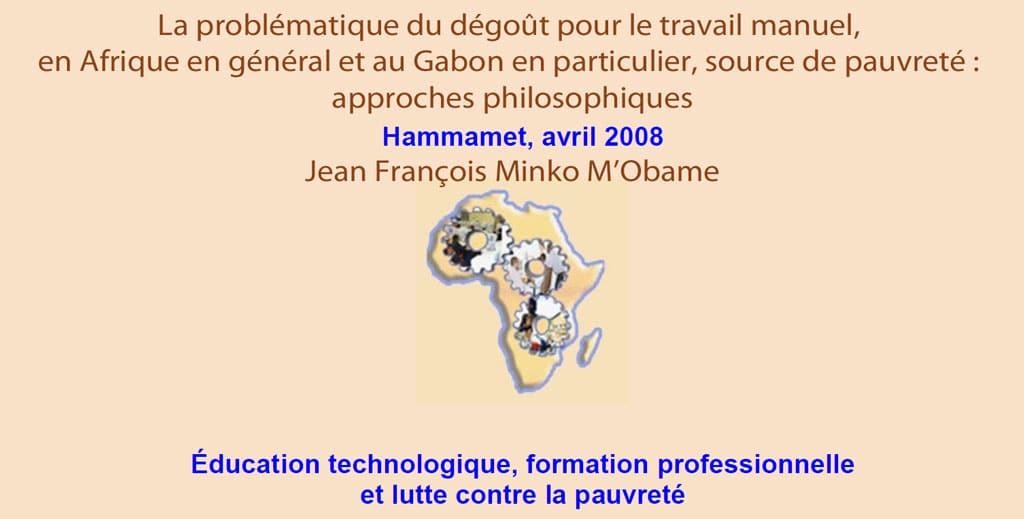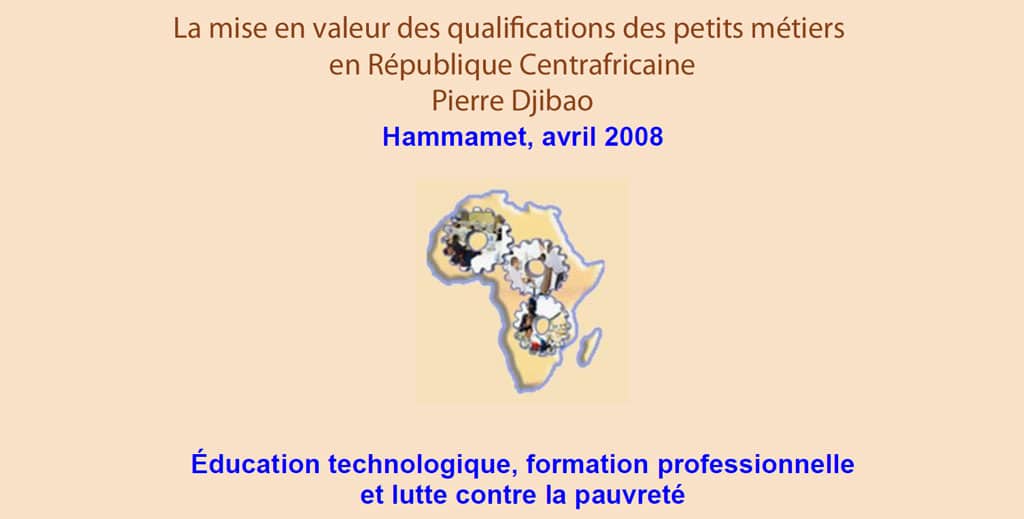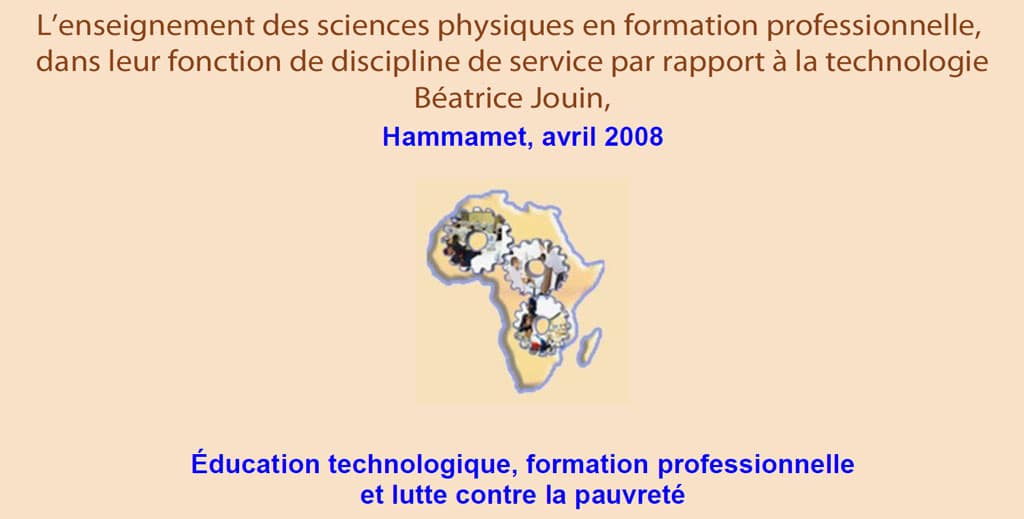Quelle utilisation du matériel de mécanique automobile dans une formation en alternance
Cyrille Ze Abaga
Summary
Alternation is looked today like the best mode of formation, to reduce the distance between school and professionals. Very little studies look after this question by the didactic level. In this communication, we will seek to alternation as a solution for the vocational schools of the poor countries without equipment in adequate materials to complete practical works (TP), studying for example the search of ignition failures on modern vehicles. We initially limit the study to identify points of similarity in the way in which the same material by the school and the company is used. Methodology calls upon the observation and talks of clarification with pupils and professor, in connection with a meeting of practice lesson. We then followed two pupils in their respective companies. Lastly, overall the preliminary results which we obtained make it possible us to say that the two institutions approaches are complementary and different, even antagonistic.
Contexte de la recherche
Le travail que nous présentons ici est un travail exploratoire sur la question suivante : les activités professionnelles au sein de l’entreprise peuvent-elles être source de construction des savoirs pour les élèves au même titre que les travaux pratiques effectués au sein de l’école ? Cette question part de deux constats faits dans deux milieux différents.
D’un côté, on remarque que l’enseignement des métiers techniques et certaines disciplines scientifiques dans des pays pauvres se fait difficilement à cause du manque d’infrastructures nécessaires et adéquates à la réalisation de certaines activités pratiques, appelées aussi travaux pratiques. Prenons pour exemple la formation des mécaniciens automobile dans les lycées professionnels du Gabon. Les élèves arrivent au terme de leur formation sans même pouvoir manipuler ou voir concrètement certains outils ou pièces de véhicule du fait que les lycées professionnels n’ont pas les moyens de s’en procurer. Face à cette situation, apparaît, chez les élèves et les professeurs, un sentiment de découragement voire d’agacement, les obligeant à écorcher la formation.
De l’autre côté, dans des pays industrialisés comme la France, on s’aperçoit que ce problème de matériels ne se pose pas avec acuité voire pas du tout. Certains de ces grands établissements de formation professionnelle de maintenance automobiles sont aussi bien équipés que des ateliers de SAV des concessionnaires. Ils tendent même à mettre en place une organisation et un fonctionnement des travaux pratiques similaires à ce que l’on peut observer dans les entreprises spécialisées dans la maintenance des véhicules.
C’est dans ce contexte d’inégalité structurelle que nous nous sommes demandé pourquoi les établissements des formations techniques et professionnelles n’initieraient-ils pas des partenariats avec les entreprises afin que leurs élèves puissent mettre en pratique les enseignements théoriques qu’ils reçoivent à l’école ? De ce fait, les systèmes mécaniques et les outils qui leur semblent sortir de la science fictions deviendront réels.
Bases théoriques
L’importance du matériel dans l’acquisition des savoirs
L’exemple des lycées professionnels des pays industrialisés nous a confortés dans notre idée selon laquelle la compétence d’un technicien ne peut être observable qu’en action. D’ailleurs ne dit-on pas que c’est au pied du mur qu’on juge le maçon ? D’où l’importance indéniable et incontournable du matériel dans l’enseignement des métiers dits manuels. L’anthropogenèse nous montre que l’une des grandes étapes de l’évolution de l’homme (intelligent) est l’ère néolithique, où l’homme façonne ses premiers outils en vu de répondre aux besoins qui se présentent à lui. Dans le même sens, le paléontologue et archéologue Leroi-Gourhan, (1992) estime que la technologie doit d’abord être vécue, pensée ensuite si besoin s’en fait sentir. Il est bon d’avoir récolté un sac de pommes de terre avec un bâton pointu avant d’envisager la description des outils agricoles, et rien ne fait mieux désirer la découverte des métaux qu’un arbre abattu et débité avec une hache de silex. En ramenant cette conception anthropologique de la technologie dans le contexte didactique, nous pouvons affirmer qu’on ne peut enseigner la technologie que dans un milieu technique (Leroi-Gourhan). Autrement dit, il serait incompatible ou incohérent de penser enseigner ou apprendre des métiers techniques sans objets techniques (outils, machines, etc.).
Le phénomène de formation en alternance.
L’histoire des systèmes de formation technique et professionnelle nous amène à nous interroger sur cette étroite relation entre le matériel et la technologie dans le domaine de la formation. Ce qui nous fait penser finalement que rapporter les théories anthropologiques de l’outil dans le domaine de la formation technique serait une vision simpliste. Sur ce point, nous le constatons d’ailleurs dans les changements qui se sont opérés dans la formation techniciens en France au cours des trois dernières décennies. Geay, A (1998) justifie l’adoption généralisée du système de formation en alternance qu’on observe aujourd’hui dans les formations technique et professionnelle par le fait que les enseignements dispensés par l’école étaient totalement coupés des entreprises. Cette justification est d’autant plus vraie qu’on puisse l’observer dans le centre de formation des apprentis où nous avons mené cette recherche. Le CFA, malgré sont incroyable équipement identique à celui du service après vente (SAV) du plus grand concessionnaire Renault de Marseille, cherche à mettre en place une alternance intégrative. L’alternance intégrative vise à prendre en compte l’expérience des élèves en entreprises afin de l’intégrer dans les enseignements dispensés à l’école. Toujours dans le même ordre d’idée, les travaux de Monaco (1993) et de Chaix (1993) dans lequel les patrons fustigent la formation assurée par l’école. On peut lire combien de fois les entreprises accusent l’école de mal former, que les jeunes diplômés venant de finir leur formation ne savent rien faire. De tout ce qui précède, on serait tenté de se demander finalement quel est le rôle de l’école ? Pour ne pas risquer de plonger dans le négationnisme envers l’école, nous nous sommes dit qu’il serait mieux de comprendre les liens didactiques qui existent dans l’alternance. Un système présenté, en l’unanimité ou presque, comme solution réconciliatrice entre l’école et l’entreprise.
Le matériel de diagnostic comme instrument
Le matériel qui nous intéresse dans cette étude est tout ce qui rentre en compte dans l’établissement d’un diagnostic d’une part, et dans l’accomplissement de la tâche d’enseigner d’autre part. On pourra citer par exemple la valise d’aide au diagnostic ; des manuels et notices du véhicule et tous les autres instruments ou appareils. Pour définir véritablement le matériel, il est important de se resituer dans notre contexte. Il s’agit de chercher à palier l’absence de matériel dans les lycées pauvres. De ce fait, nous proposons qu’il y ait un partenariat étroit entre l’entreprise et l’école pour que les élèves puissent combler le manque de travaux pratiques. Nous tenons donc à souligner qu’il ne s’agit pas seulement d’apprendre une simple manipulation de l’outil puisque cette manipulation n’est pas différente qu’on soit en entreprise ou qu’on soit à l’école. Mais plutôt l’usage qu’on en fait, face à un même type de tâche. En d’autres termes, il s’agit de voir, pour un même type de tâche, comment le matériel est mobilisé ? Quel type de matériel est mobilisé pour exécuter cette tâche dans l’entreprise et à l’école ? Dans cette optique, nous donnons au matériel le sens d’artéfact en ce sens que nous ne le considérons pas comme un simple outil dénué de tout sens. Mais comme des instruments, entendant par là, une entité bicéphale, mixte, à la fois artefact et mode d’usage (Rabardel, 1995, p. 91). En effet, les appareils et outils de contrôle tels que la valise de diagnostic ; multimètre ; le pied à coulisse comportent déjà des informations ou des instructions mises à disposition des utilisateurs par le concepteur. Dans ce cas, il s’installe alors une médiation entre l’utilisateur et l’objet au cours de l’activité. Henderson et Kyng (1991) montrent qu’un matériel instrumentalisé peut subir des modifications à trois niveaux : (i) le choix entre les options prédéfinies au cours de sa conception initiale (niveau fonctionnel), (ii) la construction de nouveaux comportements de l’artefact à partir d’éléments existants. Il s’agit de modifier l’organisation d’éléments déjà existants par groupement d’opérations, reconfiguration etc. ; (iii) la transformation de l’artéfact en lui-même. En ce qui nous concerne, nous concentrerons notre attention sur le premier niveau fonctionnel. C’est donc voir la fonction ou les fonctions que le matériel remplit lorsqu’il est utilisé à l’école et en entreprise en se référant aux fonctions prédéterminées pour lesquelles l’appareil a été conçu.
Méthodologie
Choix du terrain
Le choix de la méthodologie que nous mettons en place afin de déceler les éléments qui nous permettrons de dire qu’il y a lieu ou pas d’exploiter les activités professionnelles effectuées en entreprise par les élèves se repose essentiellement sur le concept d’instrument développé par Rabarbel, d’une part et le caractère collaboratif de l’alternance d’autre part. La finalité de la recherche que nous entreprenons étant de chercher à exploiter les activités professionnelles effectuées par l’élève en entreprise à des fins pédagogiques dans les lycées manquant de matériel, il convient de jeter un regard croisé sur la manière dont est utilisé le matériel de maintenance automobile dans l’entreprise et dans les lycées qui en sont équipés. Par ailleurs nous avons choisi de travailler avec la classe de Terminale Bac pro parce que nous pensons qu’à ce niveau, les élèves ont déjà une certaine expérience pouvant rendre les interactions entre eux et les formateurs (professeur et tuteur).
Recueil de données
Afin de pouvoir déceler les éléments qui pourraient nous permettre d’envisager l’exploitation des activités professionnelles effectuées en entreprise par les élèves et donner à ces activités une valeur plus ou moins proche à celle des TP, pour les lycées manquant de matériel, nous avons choisi le diagnostic du système d’alimentation essence sur une Clio 2. Ce choix se justifie par le fait que le diagnostic constitue la seule activité complexe que l’on rencontre régulièrement. Notre stratégie est donc d’observer l’usage du matériel identique à l’entreprise et à l’école, pour le même type d’activité (diagnostic sur les systèmes d’alimentation essence) dans les deux milieux (CFA et entreprise). En clair, il s’agit d’observer principalement à quel moment et quel outil est choisi pour effectuer telle ou telle opération ? Quel discours est entretenu autour du matériel utilisé par rapport à la tâche à exécuter ? A coté de ces observations, nous avons prévu nous entretenir avec les différents acteurs (élèves, professeur et tuteur) en vu d’expliciter certains faits qui auront retenu notre attention au cours de la séquence. Les principales questions portaient sur : (i) les conceptions sur le matériel utilisé par rapport à l’activité qu’ils ont fait, (ii) la démarche de diagnostic, (iii) l’encadrement des jeunes, (iv) les interactions entre les élèves et le professeur ou et tuteur autour du choix du matériel à utilisé
Analyse des données
Nous avons eu du mal à analyser indépendamment les données recueillies par les entretiens et celles recueillies par les observations. Toutes ces données sont complémentaires les unes des autres du fait que la plupart des questions posées aux différents acteurs visaient à remplacer les observations que nous devions faire en entreprise si nous avions eu l’occasion de le faire. En clair, nous avons traité en même temps et de façon non séparée, les données recueillies par l’observation et par les entretiens. Un des principaux outils dont nous nous sommes servis pour analyser nos données est le mode opératoire ou fiches techniques que le constructeur Renault met à disposition des techniciens. Ces documents représentaient pour nous une référence par rapport à ce qui se fait. Ces fiches comportent, pour une opération spécifique, le matériel à utiliser pour réaliser cette opération. La fiche technique peut aussi donner d’autres indications permettant au technicien d’utiliser efficacement et à bon escient le matériel. Ces fiches nous ont été utiles en ce sens qu’elles ont été notre objet de référence par rapport à l’utilisation réelle qu’en font les utilisateurs du matériel.
Résultats
L’analyse des données nous montre qu’il existe effectivement des différences entre l’entreprise et l’école au niveau de l’utilisation d’un même matériel disponible pour exécuter la même tâche. L’utilisation du matériel en entreprise et à l’école se diffère essentiellement au niveau du temps (l’emploi de la valise) et du conformisme aux instructions du concepteur ; le tout dirigé par les logiques ou conceptions personnelles et institutionnelles (logique de production pour l’entreprise et logique de formation pour l’école). Nous prendrons un exemple pour chaque cas afin d’illustrer tout cela.
Différences liées au conformisme
En comparant par exemple la liste du matériel nécessaire à la réalisation du diagnostic sur le système d’alimentation (essence) de la Clio 2 fournie par le constructeur, on s’aperçoit que la batterie n’en fait pas partie. Or un élève qu’on nommera Jean pour garder l’anonymat a utilisé la batterie comme un instrument de contrôle. Jean, pour contrôler le fonctionnement du relais de la pomme à essence, a dû utiliser la batterie au détriment du multimètre qui pourtant se trouvait sous ces yeux. La réaction du professeur a été d’ailleurs vive. Le professeur en voyant Jean faire cela l’a aussitôt arrêté et improviser un cours pour lui apprendre à se servir du multimètre. Cependant, l’élève nous a répondu à la question de savoir d’où il a appris à contrôler le relais électrique de cette façon ? : « nous, on fait comme ça souvent au garage ». Cet exemple est parmi tant d’autres. Cela nous montre qu’il existe des catachrèses au sein de l’entreprise. Les recherches en ergonomie portant sur la sécurité au travail, par exemple Faverge (1970) définit généralement les catachrèses comme un concept désignant le détournement de l’objet par rapport aux fonctions prévues par leurs concepteurs à ce qu’ils imaginaient et anticipaient de l’usage. Dans notre cas ici, le concepteur de la batterie d’accumulation n’a jamais pensé qu’elle pourrait faire l’objet d’un contrôleur de tension, de résistance et de courant électriques.
Différences liées à l’utilisation du matériel dans le temps et les conceptions des acteurs
En entreprise l’élève travaille en autonomie dès que ce dernier est jugé par son tuteur capable ; le plus souvent par les critères du cursus scolaire de l’élève. Le tuteur estime que l’élève est capable de se débrouiller tout seul lorsque ce dernier vient d’un CFA ou d’un lycée technique. L’expression se débrouiller employé par le tuteur implique que l’élève à la liberté, au niveau matériel, de choisir ces outils quand et comme il veut. Nous avons constatés que les élèves se précipitent sur la valise d’aide au diagnostic. Par contre, à l’école, nous avons remarqué qu’une fois le professeur leur dit la tâche à effectuer et qu’il lance l’exercice par cette phrase : voilà, vous avez tout et vous savez ce que vous avez à faire, tous les élèves commencent par consulter le manuel de réparation et les fiches techniques du véhicule sans même essayer de par eux-mêmes de constater la panne. Ce n’est qu’après et au fur et à mesure et selon les différentes hypothèses de recherche des uns des autres, qu’ils commencent à toucher les autres outils (les appareils et instruments de mesures et de contrôle). Mais jamais aucun des élèves n’a droit d’utiliser la valise d’aide au diagnostic avant l’établissement formel du diagnostic. La valise d’aide au diagnostic qui initialement est conçue pour déterminer au premier plan la panne est utilisée à l’école comme un vérificateur. Ce qui fait que les élèves, lorsqu’ils travaillent au CFA, vous répondent de manière caricaturale que la valise ne sert à rien. Ils sont tous d’accord avec le professeur qui la leur interdit sous prétexte la Clip leur affiche directement la panne (…) Quelle sera alors la différence entre eux et l’ouvrier ? Si je leur laisse utiliser la valise, ils ne vont plus réfléchir… Pourtant lorsqu’on a observé l’élève Jean en entreprise, le premier outil qu’il a touché fut la valise de diagnostic.
Conclusion
L’étude que nous venons de réaliser fait apparaître quelques différences au niveau de l’usage et considération que font les différents acteurs de l’alternance. Mais en regardant les choses dans le sens de notre question, nous pouvons dire que ces quelques différences ne peuvent pas constituer un frein à l’idée d’envoyer les élèves de manière alternée et structurée en entreprise afin de palier leur manque d’activités pratiques. Il faut cependant noter que la faiblesse numérique de l’échantillon ne peut nous permettre de généraliser ni même conforter ces résultats. En effet, nous avons bien voulu mener nos observations et enquêtes sur un plus grand nombre d’établissements de formation et d’entreprise afin de conforter et d’affirmer les données par les statistiques d’abord entre plusieurs établissements de formation et ensuite entre les entreprises elles-mêmes. Enfin, nous aurions pu comparer les données confirmées des établissements de formation avec celles des entreprises. Cela n’a pas pu se réaliser essentiellement du fait qu’il n’y a qu’un seul établissement de formation professionnelle en mécanique automobile qui emploie le type d’alternance que nous recherchions. C’est pourquoi, ces résultats constituent une esquisse de cette recherche. De même que la méthodologie que nous avons employée devrait nous servir de feuille de route pour réaliser de nouveau cette étude sur un plus large échantillon.
Bibliographie
Chaix, M.L. (1993). Se former en alternance : le cas de l’enseignement technique agricole. Paris : Éditions L’Harmattan
Faverge, J.M. (1970). – L’homme agent d’infiabilité et de fiabilité du processus industriel. Ergonomics, vol. 13, n° 3, pp 301-327.
Geay, A. (1998). L’école de l’alternance. Paris : Éditions harmattan.
Henderson, h., et Kyng, M. (1991). There’s no place like home : continuing design in use, in Greenbaum J., King M. eds. Cooperative design of computers, IEA, Laurence Erlbaum associates, publishers.
Leroi-Gourhan, A. (1973). Milieu et technique. Paris : Éditions Albin Michel.
Monaco, A. (1993). L’alternance école-production. 1e édition, Paris : Presse Universitaire de France.
Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies : Une approche cognitive des instruments contemporains, Paris : Armand Colin
Résumé
L’alternance est regardée à ce jour comme le meilleur mode de formation, pour réduire l’écart entre l’école et le monde professionnel. Très peu de travaux abordent la question sur le plan didactique. Dans cette communication, nous chercherons à savoir si l’alternance peut être une solution pour les lycées professionnels des pays pauvres ne pouvant pas s’équiper en matériels adéquats pour réaliser les travaux pratiques (TP), étudiant par exemple la recherche de pannes sur des véhicules modernes. Nous nous limitons d’abord à identifier des points de similitude dans la façon dont est utilisé un même matériel par l’école et par l’entreprise. La méthodologie fait appel à l’observation et à des entretiens d’explicitation avec élèves et avec professeur, à propos d’une séance de TP sur la recherche des pannes d’un système d’alimentation. Nous avons ensuite suivi deux élèves dans leurs entreprises respectives. Enfin, globalement les résultats préliminaires que nous avons obtenus nous permettent de dire que les deux institutions sont complémentaires et différentes, voire antagonistes.