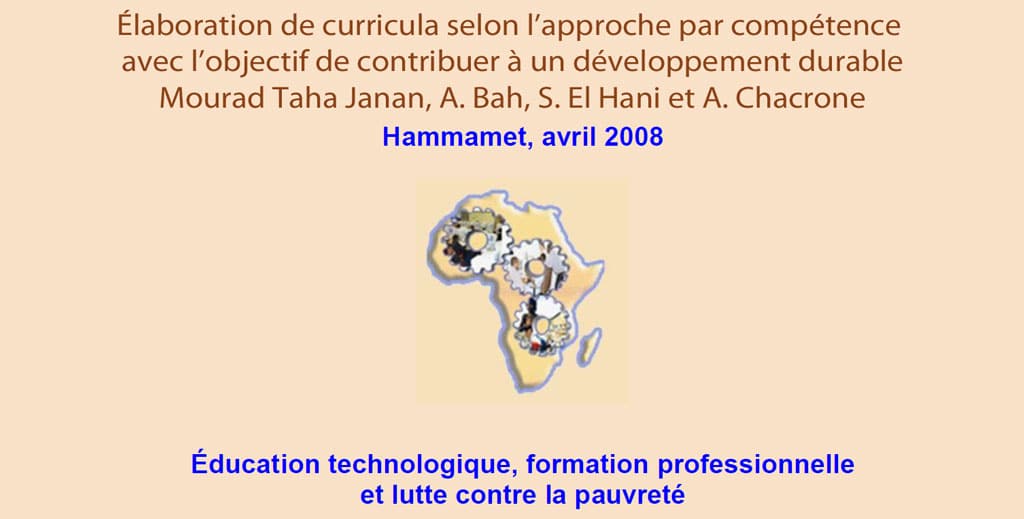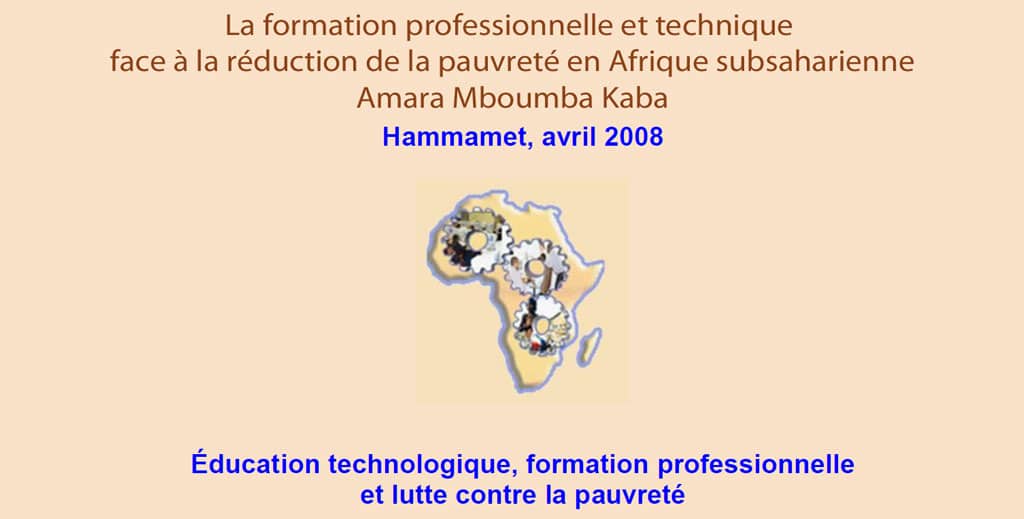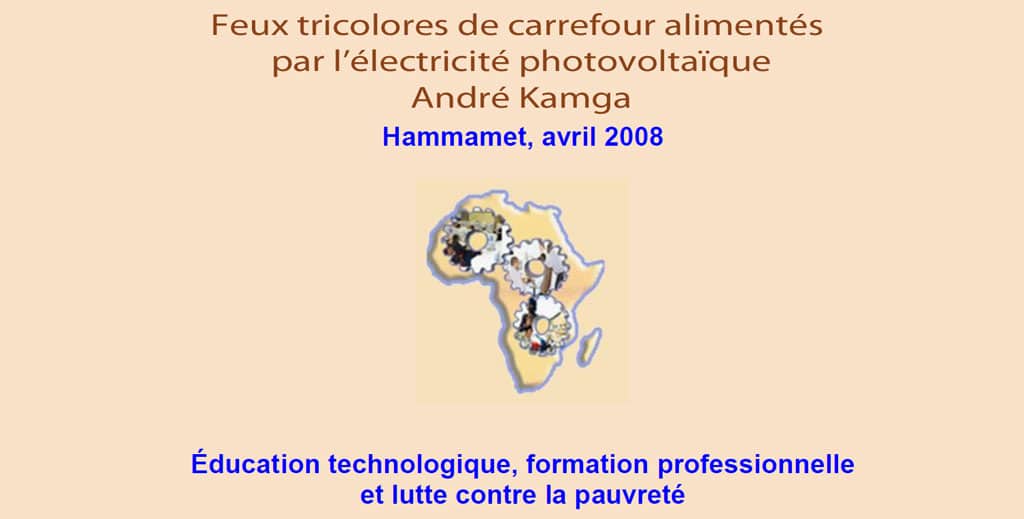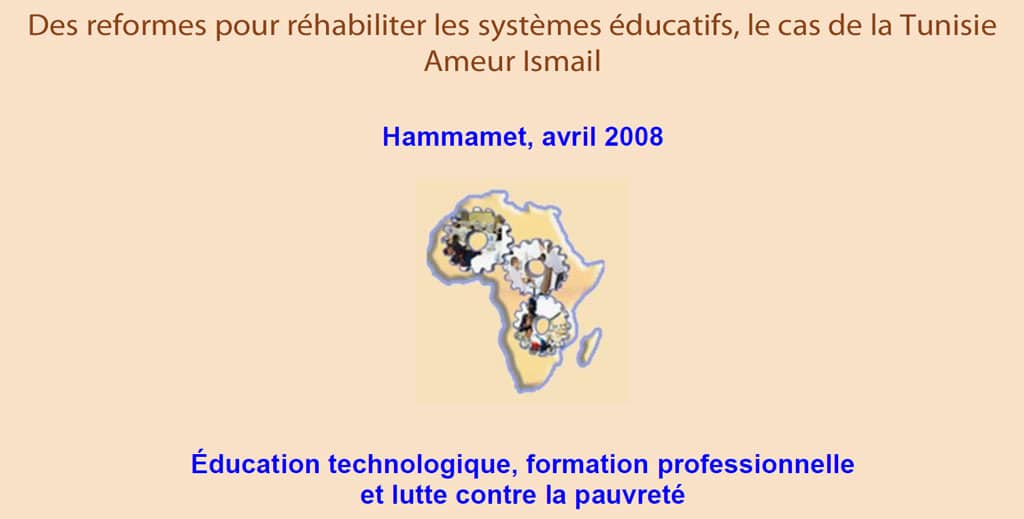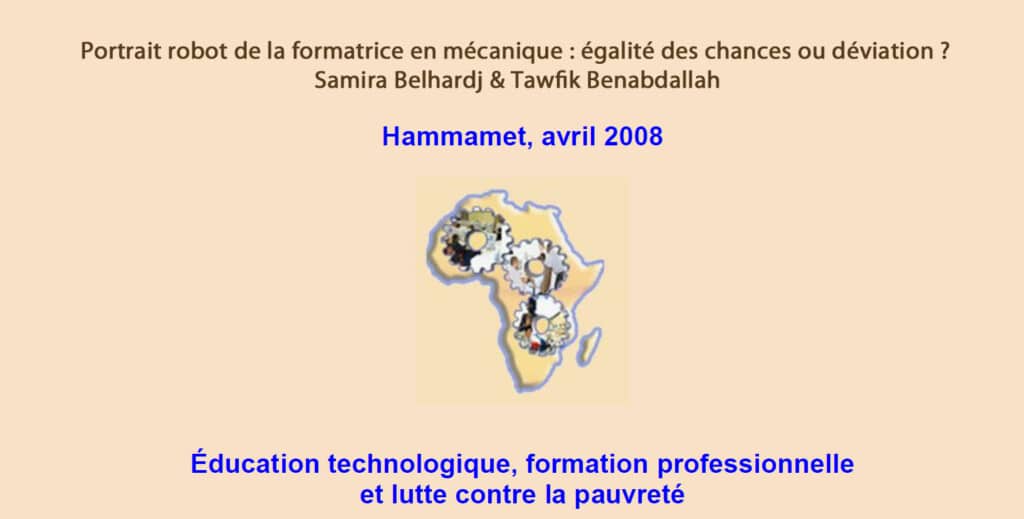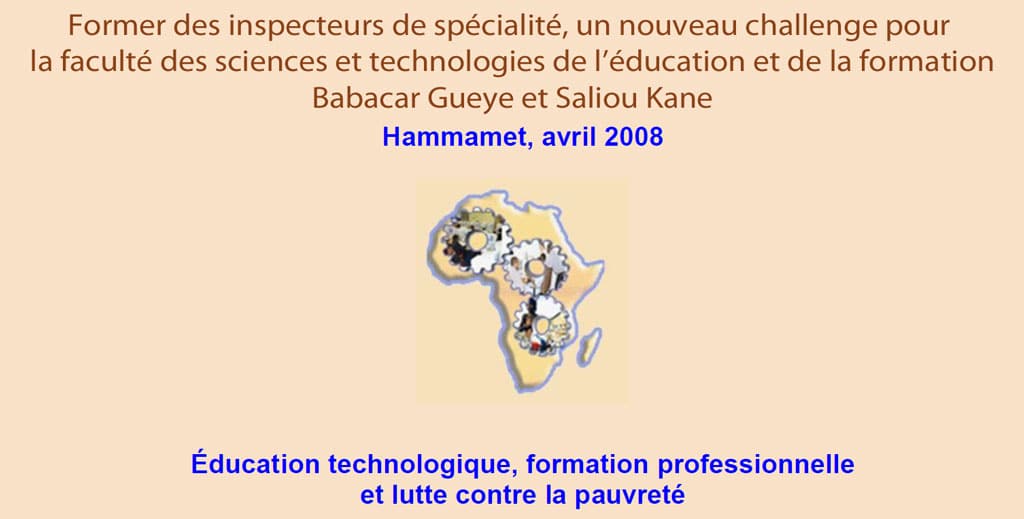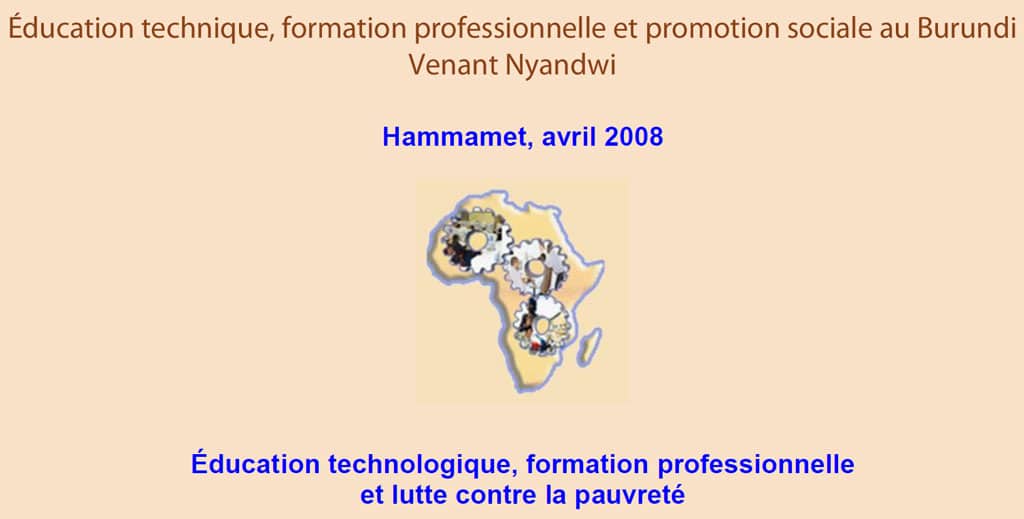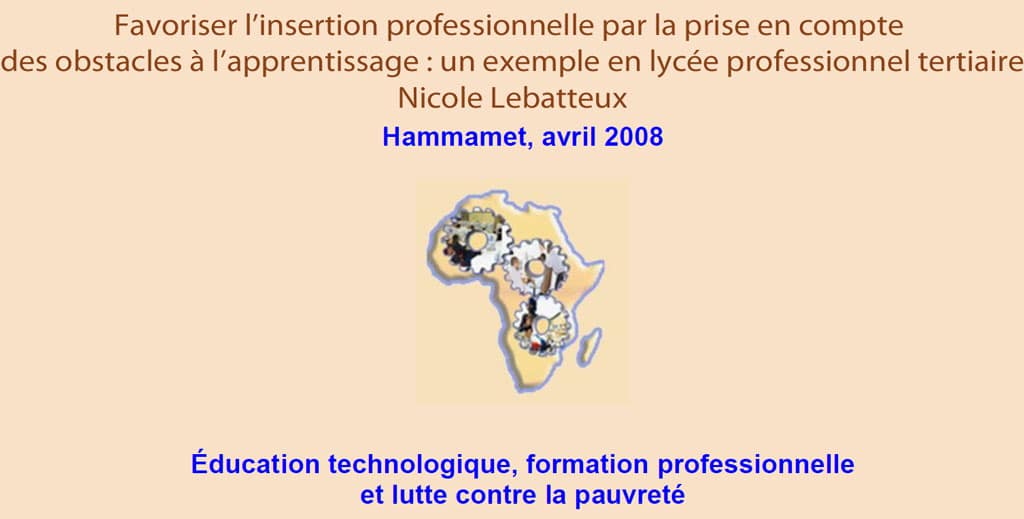Sciences, technologies ou techno-sciences Quels concepts pour quels choix didactiques
Oussama Ouarda & Jacques Ginestié
Summary
The communication is based on an historical and epistemological analysis of concepts: techniques, technology, sciences, what makes possible to locate the techno-sciences. The comparison of the epistemological and didactic approaches makes it possible to test the relevance of each discipline compared to the process of sciences and technology training and teaching. One can note the limits of a cutting and a strict disciplinary fragmentation, which weakens the meaning of each one. The approach by the teaching of the techno-sciences would make it possible to develop an interdisciplinary approach more in connection with the current evolutions.
Introduction
L’organisation de l’enseignement secondaire tunisien suit des découpages et des rituels particulièrement rigides. Ces rituels concernent non seulement les méthodes d’enseignement, qui sont souvent stéréotypées, mais aussi un découpage horaire strict qui impose le même rythme et les mêmes progressions quasiment identiques pour tous. Les connaissances sont souvent fragmentées dans un ensemble de disciplines qui semblent isolées. Ce découpage disciplinaire crée des hiérarchies qui favorisent certaines disciplines scolaires, comme les sciences physiques et les mathématiques, au détriment d’autres, comme par exemple des disciplines qui relèvent des domaines techniques ou/et technologiques. Cette valorisation de certaines disciplines a des répercussions didactiques néfastes. Ce favoritisme disciplinaire se traduit par les horaires, les coefficients affectés dans les examens, les diplômes attribués à chaque discipline pour chacune des filières… Une telle organisation soulève un ensemble de questions concernant le découpage disciplinaire qui n’est quasiment jamais interrogé : est-il justifié ? Y a-t t-il vraiment des pratiques uniquement scientifiques et d’autres technologiques ? Ces pratiques ne sont elles pas plutôt technoscientifiques ? Sur le plan didactique, ce découpage disciplinaire est-il justifié ? Sur le plan didactique, n’est-il pas mieux, d’adopter une approche interdisciplinaire ? Comment justifier ce découpage disciplinaire alors que les nouveaux programmes disciplinaires adoptent une perspective constructiviste ?
Analyse des concepts : sciences, technologies, techniques et techno-sciences
Une discipline scolaire est une construction sociale et historique qui s’impose en réponse à des situations sociales plus ou moins bien identifiées et pour lesquelles existent des modélisations particulières. Les disciplines sont une manière de classer, d’organiser, d’enseigner et de sérier les problèmes (Fourez, 2003, p. 66). Une discipline n’est pas éternelle et son existence n’est pas évidente. Fourez (2003, p. 67) précise que plusieurs épistémologues et historiens considèrent qu’une discipline naît, vit et meurt sous l’effet de facteurs externes, souvent liés aux pouvoirs politiques, socio-économiques, industrielles et militaires… En plus, une discipline évolue et se transforme au cours de l’histoire. Une discipline porte toujours des projets et des intentions plus ou moins explicites. Elle engendre des représentations du monde adéquates avec ses projets. Ceci suppose qu’une communauté scientifique s’est établie en organisant ses savoirs et en véhiculant des manières de voir et d’agir entre ses membres (Fourez, 2003). Chaque discipline développe une éthique déterminant ce qui est une bonne pratique scientifique. Des traditions s’instaurent entre les membres de cette communauté scientifique (débat critique, épreuves expérimentale ou théoriques, méthodes scientifiques,…). Ceci concerne, aussi, les sciences et les technologies. Ces derniers développent leurs traditions standardisées, leurs paradigmes et leurs propres conceptions des pratiques technologiques liés à leurs projets. Pour certaines disciplines scientifiques, comme la physique, la chimie ou les mathématiques, ce mode de définition d’une épistémologie scolaire semble tout aussi inévitable que nécessaire. Ce caractère fort leur vaut l’attribution du statut de disciplines normalisées ou standardisées, ce qui renforce leur position de disciplines dures qui a tendance à totalement obérer le lent d’un processus historique qui a conduit à cette standardisation et qui a conduit à leur stabilisation telle que nous pouvons l’apprécier aujourd’hui. De fait, les objets d’étude de ces disciplines scientifiques portent sur des ensembles de situations sociales approchées selon une perspective particulière, soutenue par des ensembles de théories portées par des institutions scientifiques qui en assurent le développement, la diffusion et la validation que ce soit au travers des publications, des diplômes universitaires reconnus socialement ou des technologies développées.
Nous sommes là dans le champ des sciences qualifiées de sciences pures ou sciences fondamentales et qui désignent des pratiques qui ne s’intéressent pas réellement aux utilisations possibles des résultats dans un contexte social. Contrairement aux sciences appliquées, les sciences pures sont caractérisées par une visée à long terme plutôt que par des résultats directs avec des objectifs instantanés. Par sciences appliquées, on désigne deux sens différents : le premier signale tout courant de pensée scientifique qui construit des représentations en vue de certains projets dans des contextes spécifiques ; le deuxième désigne les technologies en prétendant que celles-ci sont de simples applications des sciences fondamentales. Ce dernier sens est refusé par les sociologues et les épistémologues des technologies car ils estiment que les technologies sont des savoirs et des savoir-faire multiples, articulés à des projets et elles construisent des représentations d’une complexité au moins égale à celle des sciences fondamentales (Andreucci, Ginestié, 2002 ; Fourez et al, 1997). D’autres part, et contrairement à ce que pensent certains, les recherches en sciences dures ne sont pas neutres et les chercheurs ne sont pas désintéressés à leurs effets sur la société, l’économie, la politique… Cette idée que les sciences fondamentales apportent les connaissances qui rendent possibles les techniques, réduisant les technologies à de simples applications des sciences n’est pas fondée du point de vue épistémologique et historique. C’est une idée basée sur des conceptions scientistes qui croit en la supériorité morale et cognitive de la science et de ses produits par rapport à toute autre forme de production de savoir. Le mythe scientiste encore vivace, qui considère que les technologies seraient de simples applications des sciences (Mathy, 2001), trouve ses origines historiques dans l’arbre de la science de Porphyre apparut au 3e siècle. Selon cet arbre des sciences, le tronc est formé par les connaissances les plus fondamentales. On trouve, ensuite, les grosses branches qui, à leur tour, se subdivisent en rameaux. Ainsi, on aurait le tronc de la philosophie naturelle séparé en branches telle que les mathématiques et la physique… sur lesquelles prennent naissance les rameaux des sciences appliquées (Fourez, 1992, p. 168-169). Il est tout à fait évident de trouver cette idée dans le tableau synoptique des disciplines scientifiques avancé par Auguste Comte (1828) qui hiérarchisait les six groupes de disciplines, en les disposant suivant un ordre de scientificité positive décroissante depuis la mathématique jusqu’à la physique sociale ou sociologie.
Tout ceci montre à quel point ces conceptions scientistes qui croient en la supériorité des sciences sur les technologies sont bouleversées, à notre époque contemporaine. Malheureusement, ce bouleversement n’a touché que partiellement les différentes communautés scientifiques et technologiques. Ce qui demande une explication. En effet, pourquoi ces idées scientistes ne sont plus vivaces au sein des chercheurs en sciences dures, en sciences humaines et en technologie ? À quel degré ? Pourquoi ce modèle scientiste est toujours adopté par nos institutions éducatives ? En effet, le modèle du système de sciences admis par Comte est celui qui est actuellement adopté institutionnellement en Tunisie et dans plusieurs autres pays. Ce modèle reste adapté aux usages socioéconomiques des connaissances. C’est ainsi qu’existe une correspondance quasi systématique entre chaque discipline, les applications qui en découlent et les métiers qui y sont associés. Ce système se révèle suffisamment souple pour être capable d’absorber des nouvelles disciplines (Le Moigne, 1995, p. 14). Pour répondre à ces questions, nous pensons qu’une revue des différences terminologiques et des évolutions sociohistoriques des concepts de science, technique, technologie et techno-sciences est nécessaire.
Technique, technologie…et la naissance de la techno-science
Le nouveau Larousse encyclopédique indique que l’adjectif technique (teknik) vient du grec (tekhne) qui désigne art. C’est à dire, tout ce qui a trait à la pratique, au savoir faire dans une activité, une discipline alors que le mot technique (nom masculin) ou enseignement technique désigne une formation professionnelle destinée aux métiers de l’industrie et du commerce. Les auteurs ajoutent que le nom féminin désigne l’ensemble des procédés et des méthodes d’un art, d’un métier, d’une industrie. Le substantif ou l’adjectif technique reste donc lié à tout ce qui relève des métiers manuels. Le nouveau Larousse encyclopédique indique que le nom féminin technologie désigne l’étude des outils, machines, techniques utilisées dans l’industrie. Les auteurs ajoutent que technologie veut dire aussi l’ensemble des savoirs et des pratiques, fondé sur des principes scientifiques, dans un domaine technique. C’est aussi la théorie générale des techniques. Remarquons que le nouveau Larousse encyclopédique ajoute le mot techno-science qui est un ensemble de recherches et d’applications qui mettent en jeu certaines sciences et certaines techniques. L’activité technique est traditionnellement conçue comme distincte de I’ activité scientifique. C’est ainsi que les grecs anciens méprisaient la technique comprise ici comme art ce qui signifiait pour eux ici métier artisanal, dans lequel s’inscrit une expression de l’idéal esthétique. C’est cette ambiguïté du mot art, qui a conféré une sorte de noblesse à la technique, à une certaine époque. En effet, le mot technique est traduit en français comme art avec un double sens : une activité artisanale (le métier grec) ou une activité d’ordre esthétique. Le mot technique retrouve au XXe siècle, le sens qu’il avait chez les Grecs – c’est-à-dire celui d’une activité – manuelle ou mécanique – orientée vers des fins pratiques. Selon cette conception, nous ne pouvons pas confondre sciences et technique : la science est contemplative, elle est de l’ordre de la théorie, la technique est de l’ordre de l’action, de la production, de la transformation, de la volonté de maîtrise. C’est cette même idée qu’on retrouve chez les philosophes du XIXe et du XXe siècle. Lalande (2002, 1106) définit le mot technique comme un ensemble de procédé bien définis et transmissibles, destinés à produire certains résultats jugés utiles (…) En un sens plus spécial (…) le mot technique se dit particulièrement des méthodes organisées qui reposent sur une connaissance scientifique correspondante. Lalande (2002) ne manque pas d’ajouter cette remarque faite par Espinas (1890,114) : il y aurait avantage (…) à pouvoir désigner ainsi, comme les grecs le faisaient, les pratiques conscientes et réfléchies à un certain degré, en opposition avec les pratiques simples ou coutumes qui s’établissent spontanément, antérieurement à toute analyse.
Remarquons que la distinction entre technique et technologie est bien présente dans le dictionnaire de Lalande (2002). Ce dernier définit la technologie comme étant une étude des procédés techniques, dans ce qu’ils ont de général et dans leurs rapports avec le développement de la civilisation. Notons que la distinction entre mot technique et technologie existait déjà chez les grecs puisque cette dernière désignait plutôt le discours sur la technique. Il provient du grec tekhnologia, qui signifie exposé des règles d’un art. Il est surprenant que le mot technologie existe, dans la langue française, avant le mot technique. Son usage remonte à 1656, il est utilisé au début dans le même sens que les grecs. Puis, en 1750, il devient traité des arts en général et enfin, en 1896, étude des techniques, des outils, des machines. (Parent, 1999). Il existe une différence entre le sens de technology en anglais et technologie en Français. En effet, technology ne désigne plus un discours sur la technique donc une science des techniques mais plutôt à une activité humaine concernée par la fabrication et l’usage d’artefacts matériels (Frey, 1991). Le sens de technology est à rapprocher plutôt à technique en français. La technologie au XXe siècle change de sens pour couvrir l’ensemble des nouvelles technologies. Elle passe d’un discours sur la technique à un discours sur l’expérience technologique. Rieu (1990, 2556–2562) précise : la notion de technologie s’est généralisée, non pas tant sous son usage anglais que pour exprimer confusément l’expérience collective, depuis les années 1970, d’une mutation du système technique qui réoriente de proche en proche l’évolution des sociétés industrielles. Il est clair aujourd’hui que l’informatique et l’informatisation de la société transforment non seulement les machines et les biens de consommation, mais aussi l’organisation du travail, nos modes de vie et nos façons de penser. Cette évolution du sens du terme technologie témoigne d’une évolution socioéconomique et historique. Le rapport entre science et techniques connaît aussi une évolution sous l’effet de cette évolution socio-économique. L’introduction de la science dans la technique est un processus qui a commencé il y a environ trois siècles. Il s’achève au 20e siècle. Les nouvelles technologies, ne sont ni des sciences ni de techniques au sens grec du terme. Elles supposent, un étroit rapport entre science et technique. Elles sont la manifestation d’une forme d’activité scientifique et technique propre au vingtième siècle (Jorland, 1992 ; Briand et Tobelem, 1998)
Mais le mode technique n’a pas envahi seulement la science, il a envahit toute nos existences. C’est ainsi que Sachsse (cité dans Hottois, 1990, 8) écrit : la technique est devenue une partie de notre vie (…) nous vivons entièrement sur le mode technique. La production technique a augmenté d’une façon exponentielle dans certaines sociétés. L’accélération de la production technique n’a pas touché la production d’innovations seulement mais le processus d’innovation lui-même. Il y a réduction du laps de temps nécessaire à la mise en application d’une idée d’une manière considérable et ce laps tend à se réduire de plus en plus (Breton, Rieu et Tinland, 1990 ; Toffler, 1970). Notre monde devient un véritable technocosme (Hottois, 1984 ; Lévy, 1990). C’est ce milieu technicien qui tend à devenir planétaire, universel, et qui trouve sa densité maximale dans la ville que nous nommons le technocosme (Hottois, 1984, 2). La transformation de notre milieu de vie en un milieu technique et la technisation de notre univers a bouleversé l’ancienne conception de la technique qui accorde un intérêt secondaire et méprisant à l’activité technique. Le mode technique ne s’arrête plus au monde physique. Il s’étale à nos propres conceptions. Ainsi la technique moderne loin d’être méprisée et négligée, comme avant, elle est valorisée et s’impose comme modèle : la pensée technique s’impose de plus en plus comme modèle d’action dans les sociétés occidentales et Il faut souligner l’omniprésence et l’omnipotence de ce mode de pensée caractéristique du modèle culturel occidental. Une nouvelle rationalité apparaît : la technique n’est plus un moyen, elle devient un modèle dont il faut s’inspirer pour agir. C’est ainsi que pour le sociologue Bell (1976, 235) : la technologie est à l’origine d’une nouvelle définition de la rationalité, d’un nouveau mode de pensée où priment le fonctionnel et la quantitatif. Les critères retenus sont l’efficacité et l’optimisation – la meilleure performance sera celle qui aura produit le plus de résultats au moindre coût et avec le moindre effort. Cette manière de voir et de juger n’est pas sans résonances dans le domaine de l’enseignement où les techniques quantitatives de l’ingénieur et de l’économiste interfèrent désormais avec les méthodes consacrées, qui mettent l’accent sur la réflexion, la continuité et la raison discursive. Les critères de cette rationalité issue de la technologie moderne sont l’efficacité et l’optimisation ce qui reflète une dimension économique de la question. Cette visée d’efficacité, de rentabilité, de profit et de profitabilité de la rationalité technique suppose l’utilisation des mathématiques et de la logique formelle comme le souligne Moles (1969, 524), nous vivons une nouvelle rationalité, qui se doit de forger des systèmes de pensée inédits, puisque le secours que nous apportent les institutions, l’histoire et l’expérience apparaît de plus en plus faible, et perpétuellement démenti par le réel. Son aide la plus efficace est celle de l’actuel rationalisme technique qu’elle trouve non pas dans les enseignements du passé mais dans la mathématique appliquée et dans la logique formelle.
Tous ces facteurs, ont fait apparaître, dans la seconde moitié du vingtième siècle, un nouvel terme pour qualifier cette interaction croissante entre la science et la technique. Il s’agit de la techno-science (ou techno-sciences ou techno-sciences, selon les auteurs). Ce concept apparaît à la fin des années 1970. Il est introduit par le philosophe belge Gilbert Hottois qui l’introduira ensuite dans la littérature scientifique pour désigner une reconnaissance du fait que les connaissances scientifiques ne sont pas uniquement codées socialement et historiquement situées, mais soutenus par des réseaux technologiques. La technique et la science s’influencent mutuellement. Avant l’ère technoscientifique, la finalité de la science était avant tout la quête désintéressée du savoir. Aujourd’hui, l’activité scientifique s’intéresse essentiellement à produire des technologies qui, en même temps, transforment l’activité des laboratoires. Avec la techno-science il y a un changement épistémologique profond : la distinction familière entre science, comme recherche fondamentale et technique tend à s’effacer. Les scientifiques, eux-mêmes, sont conscients, qu’ils doivent orienter leurs recherches dans un contexte d’application (Gibbons et autres, 1994) s’ils veulent obtenir de budgets pour effectuer de la recherche fondamentale. En d’autres termes, ce qu’ils appellent recherche fondamentale doit avoir pour finalité la production de nouvelles technologies sinon il n’y aura pas de recherche ! La distance entre ce qu’on appelle recherche scientifique fondamentale et technique s’efface, ces dernières ne sont donc plus des applications de la recherche fondamentale : elles sont cette recherche. Seguin (1987, 155-158) remarque que la recherche artisanale et solitaire est bien dépassée : Depuis la seconde moitié du XXe siècle, l’organisation de la recherche scientifique, après s’être calquée sur celle de la grande entreprise, s’est orientée graduellement vers le modèle bureaucratique en vigueur aujourd’hui ; même au sein des universités, qu’il n’y a pas tellement longtemps, se vantaient d’être les derniers bastions de la recherche fondamentale et libre de toute contrainte, le modèle bureaucratique s’est imposé. Que s’est-il donc passé pour que les universités américaines ne soient devenues que de simples agences fonctionnant à même les contrats de recherche octroyés par le gouvernement américain, à des fins souvent militaires ? La militarisation de la science apparaît surtout à travers le rôle pilote que joue le secteur militaire dans la recherche. Ainsi la recherche scientifique s’est transformée totalement. L’emploi de termes comme complexe-scientifico-militaro-industriel (Thuillier, 1988) et Big Science (Waysand, 1974) (pour qualifier l’association science- technique) trouvent toutes leurs significations.
Ces termes désignent les rôles gigantesques des technologies, de la pratique, de l’économie, du secteur militaire et de la politique dans l’entreprise scientifique. Le phénomène technoscientifique propre à notre époque est dû entre autres à tous ces facteurs socioéconomiques et politico-militaires. Bien que le terme techno-science ait été introduit par le philosophe par Hottois (1984), le concept de techno-science doit être compris comme étant essentiellement un concept sociologique, c’est-à-dire comme désignant un phénomène social contemporain. Remarquons que le vocable techno-science a été repris depuis par de nombreux auteurs suivant plusieurs acceptations. En essayant de mettre de l’ordre dans la multitude des discours sur ce nouvel concept, Prades (1992) indique la difficulté de réaliser la synthèse de ces discours. Nous pensons que cette difficulté provient essentiellement du fait que les auteurs avaient plusieurs champs disciplinaires et de leurs positions épistémologiques qui sont différentes. En effet, le terme techno-science remet en question la conception traditionnelle de la science selon laquelle celle-ci est neutre et qu’elle est prévue à la quête exclusive et désintéressée de la connaissance, ce qui déclenche un débat entre les tenants des deux positions… Pour Fourez et Latour, la techno-science (ou techno-sciences pour Latour) est un phénomène social : c’est une construction susceptible de changement suivant la volonté humaine et tributaire – au moins en partie – de choix posés par l’humain. Pour Fourez, il n’est pas possible de dissocier sciences et techniques. Fourez (1996, 133) indique : sciences et technologies semblent être aujourd’hui complètement liées ; au point qu’il est difficile de déterminer quels développements doivent être considérés comme techniques et lesquels seraient scientifiques. Comme nous le voyons dans le cas des semi-conducteurs. Un progrès technique entraîne un progrès scientifique et vice-versa, presque continuellement (…) Le mariage entre sciences et techniques semble donc déjà être consommé et certains estiment qu’il faut aujourd’hui parler de techno-science (…) Dans quelle mesure cela changera-t-il de plus en plus la méthode scientifique concrète, c’est-à-dire les méthodes pour produire des résultats ? On peut déjà observer ces mutations en examinant le lien des universités avec les industries. L’avenir nous le dira sans doute. Mais ce mariage entre sciences et techniques montre, à qui en douterait, qu’il n’existe pas une seule science : les pratiques scientifiques se modifient sans cesse.
Pour Latour, il faut distinguer entre la science qui est en train de se faire et les résultats de la science, c’est à dire, de la science toute faite : c’est par la porte dérobée de la science en train de se faire (que) nous accéderons à la science et a la technique (Latour, 1989, 12). Pour lui, le vocable techno-sciences doit être toujours au pluriel. Il désigne des activités scientifiques. Pour Latour, cette invention de la distinction entre science et technique découle de la confusion entre les résultats de l’activité scientifique et la science en tant qu’activité sociologique, qu’il appelle science en action. Pour lui, l’activité scientifique, n’est ni neutre, ni pure, ni objective. Pour Latour, les façons d’étudier la science sont inappropriées, puisque les épistémologues et les sociologues ont toujours cette tendance à séparer les énoncés des contextes sociaux. La perspective de Latour était essentiellement sociologique et elle s’opposait à la position de Hottois, qui défendait le concept philosophique de techno-science, ainsi que celle des scientifiques et des philosophes qui persistaient à distinguer science et technique. Pour Lui, la seule façon de comprendre les techno-sciences est de les regarder d’un point de vue sociologique en considérant tous les facteurs (humains, l’argent, les relations entre chercheurs, les alliances, les réseaux qui se créent ou qui ne peuvent pas être crées, la politique, l’économie, …) comme partie intégrante d’un réseau fonctionnel en société. En effet, lorsqu’on regarde la science en train de se faire, les sciences et les techniques sont des activités en constante interaction. Pour Latour, la séparation entre science et technologie est artificielle, elle est un paquet fabriqué par certains chercheurs pour résoudre des problèmes de priorité, de préséance, de responsabilité et d’étiquette, pour exclure le travail de ceux qui ne portent pas de blouse blanche et pour couronner quelques lauréats du prix Nobel (Latour, 1989, 282). En résumé, bien que les techno-sciences sont contestés par certains (Schatzmann, 1987 ; Jacques, 1987) et bien que le mot de techno-sciences prends des différentes acceptations, il s’avère plus pertinent. En effet, non seulement il explique l’injection et la fusion de science dans la technique mais il donne aussi une image de la science qui est entrain de se faire au lieu d’une image traditionnelle, qui non seulement sépare l’activité scientifique et l’activité technique mai elle donne à la première une conception erronée de la science et lui attribut une image neutre, objective et vraie. La conception traditionnelle de la science considère celle-ci comme une recherche de connaissances désintéressées, envisagées indépendamment de toute application possible. Selon cette conception, la technique, est une démarche complètement séparée de la démarche scientifique, ce sont deux processus intellectuels distinct (Schatzmann, 1987). La technique n’est qu’une application des connaissances scientifiques, d’où l’utilisation d’expressions telles que sciences pures pour désigner la science et sciences appliquées pour désigner la technique et les technologies. Il sera évident, pour cette conception, que l’utilisation du néologisme techno-science, techno- sciences ou techno-sciences est injustifiée. Francis Jacques et Evry Schatzmann considéraient que le concept de techno-science était un concept réducteur, c’est un abus de langage et les arguments épistémologiques avancés pour la construction de ce néologisme n’avaient aucune valeur. Comme nous l’avons précisé auparavant, le néologisme sociologique de Bruno Latour techno-sciences est plus pertinent car il explique mieux une science qui est entrain de se faire, qui est entrain de se construire et non pas une science neutre objective qui découvre la réalité et la vérité souvent comprise comme absolue. Cependant, l’utilisation de ce néologisme est-elle justifiée sur le plan didactique ? Est-il plus pertinent d’enseigner la techno-science ou d’enseigner la science et la technologie (ou la technique) séparément l’une de l’autre ? Peut-on enseigner actuellement les techno- sciences ? Quelles est l’approche(s) didactique(s) la mieux adaptée ? C’est ce qu’on essayera de répondre dans le paragraphe suivant.
Des disciplines… et des choix didactiques
Savoirs technologiques et savoirs scientifiques ou savoirs technoscientifiques
Nous nous fondons, dans les paragraphes qui suivent, sur des recherches en épistémologie, sociologie, histoire et didactiques de la technologie et des sciences. L’essentiel de ces travaux est récent, surtout les travaux qui concernent la technologie. Notons aussi que ces travaux sont situés dans une perspective épistémologique traditionnelle qui n’adopte ni la position de Latour ni celle de Hottois. Pourtant peu de chercheurs défendaient un modèle hiérarchique de dépendance qui présente la technique comme ancillaire et impliquant simplement des applications de la science. Ce point de vue, comme l’indique Layton (1994, 125) est insoutenable sur le plan historique et par rapport à la science, la technique n’est plus considérée comme lui étant subordonnée ; la relation est caractérisée par l’égalité, la symbiose et l’interaction. Mayr (1976, 668, cité dans Layton, 1994) a approfondi cette thèse en indiquant qu’il n’existe pas de critères pratiques utilisables pour établir des distinctions claires et nettes entre la science et la technique. Ce même point de vue est exprimé par Fourez (1996,133) lorsqu’il indique sciences et technologies semblent être aujourd’hui complètement liées ; au point qu’il est difficile de déterminer quels développements doivent être considérés comme techniques et lesquels seraient scientifiques. Thackray (1976, 645) (Cité dans Layton, 1994) indique que les catégories d’analyse science et technique ne sont pas des catégories qui éclairent notre compréhension de ces activités. Ceci a conduit Staudenmaier (1985) à avancer sa thèse sur les caractéristiques du savoir technologique. Selon cette thèse, il y a quatre formes caractéristiques du savoir technologique. (i) Les concepts scientifiques : avant de contribuer aux savoirs technologiques, les concepts scientifiques doivent faire l’objet de restructuration et d’une adaptation aux exigences spécifiques du problème de conception considéré. Le rôle de la science dans la relation science-technique n’est celui du partenaire supérieur, mais c’est plutôt le contraire qui est vrai. (ii) Les données problématiques : ils renvoient aux zones d’ignorance auxquelles les techniciens doivent trouver une solution. Les techniciens ne doivent pas attendre le progrès de la science et il faut trouver une solution qui utilise la meilleure approximation. (iii) La théorie des différents génies est une caractéristique principale du savoir technologique, dans laquelle figurent pour partie les concepts scientifiques et les données problématiques Layton (1994,127). Stauderman (1985, 108) définit ce terme employé en histoire des techniques comme un corpus de connaissances mettant en œuvre des méthodes expérimentales en vue de construire un système intellectuel formel et mathématiquement structuré (…qui) rende compte des caractéristiques comportementales d’une classe particulière d’artefacts ou de matériaux se rattachant à des artefacts. (iv) La compétence technique est l’application de ce savoir codifié des différents génies. Remarquons ici que non seulement le savoir technologique interagit avec le savoir scientifique et que cette interaction est essentielle et nécessaire, mais que ce dernier fait partie intégrante du savoir technologique. De même que la technologie fait partie intégrante des pratiques de recherches scientifiques. Doit-on parler alors de technologie et de sciences ou de techno-sciences ? Peut-on séparer enseignement des sciences et des techniques ou doit-on au contraire enseigner les techno-sciences ? La division et le morcellement disciplinaire adapté actuellement dans l’éducation des sciences et des techniques est-il justifié d’un point de vue didactique ? C’est ce qu’on essayera d’éclaircir dans les paragraphes suivants.
Savoirs scientifiques…scientifiques, grands publique et apprenants
Examinons maintenant la nature du savoir scientifique tel qu’il est perçu par le grand publique et les scientifiques. Layton (1994, 132) précise que plusieurs recherches indiquent qu’il y a un grand écart entre les connaissances scientifiques et la compréhension de la science par le grand publique. En plus, la science est perçue implicitement comme non problématique, une entité agglomérée, unique, d’une importance capitale pour les activités quotidiennes. Quant aux scientifiques, il apparaît un désaccord entre eux sur ce qui constitue la science et sur la nature du savoir scientifique dans un contexte spécifique donné (Wynne, 1990, 6). Les désaccords concernent les frontières de la science et ce qui tenu pour savoir scientifique dans un contexte particulier. Ce désaccord entre les scientifiques apparaît surtout dans les instances juridiques statuant sur des conflits liés à l’environnement. Il touche les faits, les interprétations, mais aussi sur ce qui constitue une approche scientifique appropriée ! La science prend alors une apparence moins solide que dans les institutions éducatives chez les experts. Les recherches montrent aussi que le savoir scientifique n’est pas utilisé par le grand public dans les pratiques de la vie courante. Pour qu’il soit accessible aux gens, il doit être retravaillé et recontextualisé. Ceci entraîne son intégration à d’autres savoirs, souvent situés et personnalisés, de même qu’à des jugements de différentes sortes (Layton, 1994, 132). Les recherches montrent aussi que les gens intègrent des liens sociaux et institutionnels lorsqu’ils utilisent les savoirs scientifiques. Pour eux la fiabilité et la crédibilité du savoir scientifique dépend de plusieurs facteurs qui n’ont rien avec la science et sans essayer de chercher des fondements scientifiques. Wynne (1990, 10) (cité par Layton, 1994) indique que l’acceptation (ou non) des sciences par le public est moins une question de capacités intellectuelles que de facteurs socio- institutionnels, qui concernent l’accessibilité sociale, la confiance et la négociation par opposition à l’imposition.
Un autre résultat est issu des différentes études, il concerne l’ignorance qui figure de façon centrale comme une caractéristique du grand public au sein d’une modélisation en termes de déficit cognitif. Une étude faite par l’université de Lancaster (Cité par Layton, 1994) essaie de clarifier la nature, la genèse et l’évolution des modèles mentaux que le grand public peut se construire face à des phénomènes et lorsqu’il est confronté à des problèmes particuliers. On raconte le cas d’une femme qui a un modèle microbien de la radioactivité. En effet, elle faisait bouillir son lait pour le décontaminer après le passage d’une pollution venant de Tchernobyl. Ceci nous rappelle les recherches didactiques faites sur les conceptions des apprenants. Ce concept de conceptions reste un concept central en didactiques de sciences. En effet, le savoir scientifique ne peut être transmis directement des enseignants aux élèves. Il doit nécessairement être construit par ces derniers afin d’être efficace. Les élèves ont des conceptions initiales qui sont acquises dans leur vie de tous les jours avant de finir leurs savoirs en milieu scolaire. Ces conceptions peuvent par conséquent être à l’origine des interférences dans leur apprentissage scolaire. Tout travail de conceptualisation doit être en premier lieu un travail sur les conceptions. La prise en compte de ces conceptions, surtout celles qui forment un noyau dur résistant doit servir de base à l’enseignement d’un concept scientifique. Sans cette prise en compte, le savoir transmis ne sera pas fiable. Il sera très vite oublié et non utilisable car il est dépourvu de tout sens. Remarquons que selon la perspective socioconstructiviste, les connaissances scientifiques demeurent viables et pertinentes dans les situations rencontrées par l’apprenant. C’est pourquoi les programmes doivent tenir compte, entre autres, de ces connaissances erronées et de l’évolution de ces connaissances. De ce point de vue, une approche socioconstructiviste devrait avoir une incidence directe sur la forme et les contenus des programmes disciplinaires. Elle ne doit pas seulement spécifier les savoirs disciplinaires à enseigner, les recommandations sur les situations à mettre en œuvre et l’horaire prévu pour chaque élément mais elle doit indiquer les démarches de construction des connaissances des élèves et expliciter la nature des connaissances, leurs modes de construction ou de transformation et leur viabilité (Jonnaert et Vander Borght, 1999). De fait, les processus de construction des savoirs, notamment dans l’articulation accommodation assimilation, devraient être au cœur des préoccupations de ces programmes scolaires (Jonnaert, 2001, 226). Dans la perspective socioconstructiviste, les connaissances construites aux préalables, restent opérationnelles tant qu’elles sont valides pour l’apprenant ; autrement dit, tant que ces connaissances lui permettent de maîtriser les compétences nécessaires dans une série de situations. On voit, à travers cela, toute l’acuité du choix des situations scolaires qui doivent être signifiantes pour l’élève et pertinentes en regard des pratiques sociales. Ce sont les situations et les contextes liés à ces pratiques sociales (et non pas les contenus disciplinaires) qui permettent à l’élève de remettre ses connaissances en cause dans un processus de pratique réflexive. La construction sociale de la connaissance montre que le contexte et les situations (ainsi que la représentation de ces situations) déterminent la signification et le sens des connaissances construites. Elle montre aussi l’importance de la signification sociale des tâches d’apprentissage qui se fait à travers les interactions sociales de natures diverses (Jonnaert, 2002). Au-delà, Jonnaert et Vander Borght (1999) ajoutent une autre caractéristique constitutive de la construction de connaissances : l’interaction des anciennes connaissances de l’apprenant avec des éléments de son milieu, ce qui lui permet de construire de nouvelles connaissances en modifiant ses anciennes connaissances et en s’adaptant à ce milieu (Jonnaert, 2002).
Nous voyons maintenant l’importance des interactions entre sciences et techniques dans l’élaboration des programmes de sciences et des techniques et dans leurs enseignements- apprentissages. Et si la nécessité de ces interactions est plus qu’évidente en technologie car le savoir scientifique (après adaptation de celui-ci) fait partie du savoir technologique, il reste nécessaire car les exigences didactiques font que les savoirs scientifiques doivent interagir avec d’autres savoirs socialement significatifs pour les apprenants. Nous pensons que les savoirs technologiques et les savoirs scientifiques sont confondus, ce sont des savoirs technoscientifiques. (Cependant, si certains ne veulent pas les considérer comme savoirs technoscientifiques, ils restent très proches !). Mais ceci ne nous empêchera pas de rapprocher les savoirs technoscientifiques avec d’autres savoirs tel que les savoirs économiques, politiques, épistémologiques… Nous ne pouvons que rejoindre le sociologue des sciences Barnes (1982) dans ses critiques du modèle de dépendance hiérarchique entre science et technique et entre disciplines. Barnes (1982, 10) posa les questions suivantes qui restent très intéressantes dans le champ de l’éducation des sciences et des techniques (ou plutôt technoscientifiques) : Pourquoi ne pas utiliser un modèle interactif de ce genre pour conceptualiser les relations de la science avec d’autres sous-ensembles culturels (que la technique) ? Pourquoi, par exemple, les relations entre des sous- ensembles culturels tels que la science et la politique, sous réserve que de telles relations existent, ne seraient-elles pas conceptualisées de cette façon, ou encore, les relations entre la science et notre culture quotidienne de sens commun ?
Enseignement technique et/ou technologique et enseignement scientifique en Tunisie
Les systèmes de médiatisation éducative en Tunisie que sont les programmes scolaires, la pédagogie et l’évaluation suivent les mêmes systèmes qui ont régné et qui ont été mobilisés en Europe pendant la deuxième moitié du 19e siècle pour définir et promouvoir la science pure comme une catégorie dominante, dégagée des contextes pratiques. Cette domination est largement fondée sur des bases d’une double tradition positivo-réaliste et béhavioriste. Elle correspond à une conception particulière de la division sociale du travail qui valorise le travail intellectuel et considère les sciences fondamentales (Mathématiques, sciences physiques…) comme plus nobles que la technologie. C’est ainsi que les disciplines technologiques sont largement marginalisées sur les plans des diplômes, des contenus disciplinaires, de la place de la culture technique, ou encore au travers des coefficients attribués à cette discipline scolaire (En première année secondaire, cette discipline est affectée d’un coefficient de 1 alors que les sciences physiques sont affectées d’un coefficient de 2,50 et les mathématiques d’un coefficient de 3) ! Ceci n’est pas sans conséquences pour les élèves et pour les professeurs, conséquences que nous pouvons situer aux niveaux pédagogiques et didactiques. Ces conséquences sont certainement néfastes car la pression exercée par l’examen est directement liée au poids de la discipline scolaire dans ce même examen. Dans cette perspective, on peut penser que les élèves attribuant un poids moins fort à l’éducation technique et l’on peut se poser la question des connaissances qu’ils construisent dans ces conditions. En effet, dans ce cas, quel rapport aux savoirs technologiques développeront-ils ? Quant aux programmes, ils sont organisés selon le découpage disciplinaire classique qui rappelle le tableau synoptique des disciplines scientifiques proposé par Auguste Comte. Dans cette perspective positiviste, les disciplines scientifiques sont mutuellement exclusives et se définissent en fonction des méthodes et des objets d’études spécifiques qui sont supposés correspondre à des morceaux de réalité (Jonnaert, 2001, 224). Plusieurs travaux indiquent que le savoir scientifique doit être retravaillé et incorporé à d’autres formes de connaissances et de jugements si l’on veut qu’il soit fonctionnel pour l’action pratique d’où l’importance des approches interdisciplinaires.
C’est dans ce cadre interdisciplinaire que l’on propose que les enseignements technoscientifiques (ou à défaut, les enseignements technologiques et scientifiques) soient faits car c’est le seul cadre qui est institutionnellement possible, au moins pour le moment. Cependant, nous considérons que l’enseignement-apprentissage des techno-sciences est possible. Ce dernier donne non seulement une image plus fiable de la science et de la technologie (techno-sciences) qui sont entrain de se faire mais il est aussi plus adapté sur le plan didactique. Le savoir technoscientifique aura un sens pour les apprenants parce que c’est un savoir théorique et pratique à la fois, qui est lié à des pratiques sociales existantes et peut être intégré, plus facilement, à des situations scolaires qui sont signifiantes pour l’élève et pertinentes en regard des pratiques sociales et pour lesquels les connaissances technoscientifiques ont plus de chance de demeurer viables et pertinentes pour les apprenants car elles sont liées à des pratiques sociales. Cependant l’enseignement des techno-sciences a besoin d’être institutionnalisé. En même temps, des recherches didactiques, pédagogiques doivent être faites aussi pour opérationnaliser ce nouvel champ disciplinaire scolaire, ce qui nécessite un temps considérable. Nous pensons que l’introduction, pour le moment, des approches interdisciplinaires ne peut être que bénéfique pour les apprenants. En effet, l’enseignement de la technologie souffre souvent d’une coupure disciplinaire avec les sciences et les mathématiques : c’est ainsi, par exemple, que certains professeurs de technologie sont obligés d’enseigner la résistance de matériaux (RDM) sans que les élèves de première année secondaire connaissent la notion de force. En effet, le professeur de sciences physiques n’a pas enseigné encore cette notion au moment où le professeur de technologie a décidé d’enseigner la résistance de matériaux. Nous nous demandons comment les élèves peuvent-ils comprendre la leçon de RDM ! Pourtant, la RDM pourra être un excellent appui à la compréhension du vecteur force enseigné par le professeur de physique et que beaucoup d’élèves trouvent des difficultés à le représenter dans des situations différentes que celles vues pendant le cours de physique. Pire, le professeur de technologie et de sciences physiques ne représentent pas de la même façon ce vecteur force. Le professeur de technologie représente le vecteur force sans considérer le point d’application. Le problème est que lorsqu’un élève utilise la même représentation que celle utilisé par le professeur de technologie, le professeur de physique la considère comme fausse et lui donne un zéro. Ces différences entre les représentations du professeur de physique et de technologie et plus généralement les interactions entre sciences et techniques doivent être signalées et étudiées… Cependant, tout se passe en silence et l’élève doit satisfaire les exigences du professeur de technologie et en même temps celui des sciences physiques, sans aucune discussion, même s’il y a une contradiction entre les deux professeurs. Remarquons à ce propos que les élèves de première année doivent aussi utiliser la notion de couple de force et que cette notion sera enseignée en physique lors de la deuxième année secondaire.
L’enseignement-apprentissage de technologie est dépourvu d’une partie intégrante de ce savoir qui est la science car les noosphères considèrent qu’il s’agit de deux champs disciplinaires différents. De même, l’enseignement de sciences souffre de plusieurs problèmes. Les cours de sciences physiques se font d’une façon traditionnelle et plusieurs élèves ne comprennent pas les notions de physiques enseignées par le professeur. Peu d’élèves comprennent le sens de ces notions car elles sont entourées par plusieurs conceptions erronées et leurs enseignements se fait d’une façon isolée de tout contexte social ce qui ne leur donnent aucun sens. Nous pensons que le choix des situations d’apprentissage en technologie comme en science doit être lié à des pratiques sociales pertinentes pour les élèves. Ces situations peuvent être liées à des problèmes (ou au moins les situations doivent être problématisées) ce qui permet d’instaurer un conflit cognitif et un conflit sociocognitif permettant aux élèves de remettre en cause certaines conceptions erronées. L’acquisition de connaissances nouvelles peut se faire aussi à travers la résolution de problèmes complexes, contextualisés dans des situations problématiques qui sont positionnées en limite supérieure de la zone proximale de développement. La résolution d’un problème complexe doit apporter des réponses pertinentes qui permettent aux élèves d’effectuer des tâches nouvelles, selon certaines pratiques qui ont une signification sociale pour lui. Au lieu d’entamer l’étude des capteurs physiques, sans que les élèves de première année secondaire ne connaissent pas les notions de physique (sauf les notions d’intensité électrique et peut être celle de la tension), nous pensons que l’étude des capteurs physique peut être utilisée pour acquérir plusieurs notions de physique. Ceci suppose, au moins, l’application d’approches interdisciplinaires, ce qui demande non seulement des réformes institutionnelles, la formation des professeurs à ces approches mais aussi de faire des recherches didactiques pour trouver des situations problématiques complexes appropriés. C’est ce que nous étudierons dans un autre article.
Références bibliographiques
Aitken H. G. J., (1985). Syntony and spark. The origins of radio, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Bell D., (1976). Vers la société postindustrielle, Paris, Éditions Robent Laffont,
Breton, P. Rieu, A.M., et Tinland, F., (1990). La techno-science en question, éléments pour une archéologie du XXe siècle, Coll. Milieux 1, Champ Vallon.
Briand P & Tobelem G., (1998). Biotechnologies : le droit de savoir. Coll. Initiatives et réflexions, John Libbey Eurotext. Paris.
Cohen-Tannoudji C., (2004). Redynamisons la recherche. Le Monde. France
Constant E. W., (1980). The origins of the turbojet revolution, John Hopkins University Press, Baltimore. Espinas A., (1890). Les origines de la technologie. Revue de la philosophie. II, pp. 114
Fourez G., (1996). La construction des sciences, Les logiques des inventions scientifiques, Introduction à la philosophie des sciences, Troisième édition revue. De Boeck Université, Bruxelles.
Jacques, F. (1987) De l’interrogation scientifique à la malédiction technologique. in Les pouvoirs de la science, un siècle de prise de conscience. Problèmes et controverses, Publications du Centre de recherches d’histoire des idées de l’université de Nice, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1987, p. 23-46
Jonnaert. P., (2002). Recherches collaboratives et socioconstructivisme. In Venturini. P ; Amade-Escot. C & Terrisse. A. (coordonné). Étude des pratiques effectives : l’approche des didactiques. Grenoble, La Pensée Sauvage, éditions.
Jonnaert P. (1996). Apprentissage mathématiques en situation : une perspective constructiviste. In
Revue des sciences de l’éducation. Vol. XXII, n°2. Québec.
Jorland G (Dir), (1992). Des technologies pour demain, biotechnologies, fusion nucléaire, laser, Supraconducteur. Coll. Points sciences. Éditions du Seuil. Paris.
G, (1984). Le signe et la technique. La philosophie à l’épreuve de la technique. Coll. Res, L’invention philosophique, Éditions Aubier Montaigne, Paris.
Gibbons M, Limoges C, Nowotny h, Schwartzman S, Scott Pet Trow M., (1994). The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. Londres, Sage Publications.
Kline, R., (1987) Science and engineering theory in the invention and development of the induction motor, 1880-1900, Technology and Culture, volume 28, pp. 283-313.
Lévy P. (1990). Les technologies de l’intelligence. L’avenir de la pensée à l’ère informatique. Coll.
Points Sciences, Éditions La Découverte.
Lalande A., (2002). Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Collection Quadrige. PUF. 1ère édition 1926.
Latour B. (1989). La science en action. Éditions La Découverte, Paris, 1989.
Layton D., (1994). Éducation scientifique et action : les relations entre les sciences enseignées à l’école et la pratique. Aster, N° 19. 1994.
Mayr O. (1976) The science-technology relationship as a historiography problem, Technology and Culture, volume 17, pp. 663-73.
Moles A., (1969). La pensée technique in La philosophie, Coll. Les idées, les œuvres, les hommes, 2e édition, Centre d’Étude et de Promotion de La lecture, Paris.
Parent M., (1999). Les implications éthiques de la techno-science. Mémoire de Maîtrise en philosophie.
Faculté de Théologie et de Philosophie. Université de Sherbrooke. Sherbrooke.
Prades J., (1992). La techno-science. Les fractures du discours, Coll. Logiques sociales, Éditions.
L’Harmattan, Paris.
Seguin F., (1987). La bombe et l’orchidée, Éditions Libre Expression.
Schatzmann E. (1987) La vitrine confuse et la réalité du pouvoir w in Les pouvoirs de la science, un siècle de prise de conscience. Problèmes et controverses, Publications du Centre de recherches d’histoire des idées de I’Université de Nice, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1987, p. 235- 243
Toffler A,. (1970). Le choc du futur. Folio Essais. Éditions Denoël.
Thuilier P., (1988). Science et société. Essais sur les dimensions culturelles de la science. Le livre de Poche. Librairie Arthème Fayard. Paris,
Thackray A. (1976). Discussion of the paper by Robert Multhauf, Technology and Culture, volume 17, 645 p.
Vincent W., (1982) Control-volume analysis: a difference in thinking between engineering and physics,
Technology and Culture, volume 23, pp. 145-74.
Waysand G., (1974). La contre-révolution scientifique ou le crépuscule des chercheurs. Éditions Anthropos, Paris.
Wynne B. (1990). Knowledge in context. Background paper from five projects. Unpublished paper presented at the Science Policy Group Dissemination Session, April 1990.
Résumé
L’article s’appuie sur une analyse historique et épistémologique des concepts de technique, technologie, sciences ce qui permet de situer les techno-sciences. La mise en relation des approches épistémologiques et didactiques permet d’éprouver la pertinence de chaque discipline en regard du processus d’enseignement-apprentissage des sciences et des technologies. On peut constater les limites d’un découpage et d’une fragmentation disciplinaire stricte qui affaiblit le sens de chacune. L’approche par l’enseignement des techno-sciences permettrait de développer une approche interdisciplinaire plus en rapport avec les évolutions actuelles.