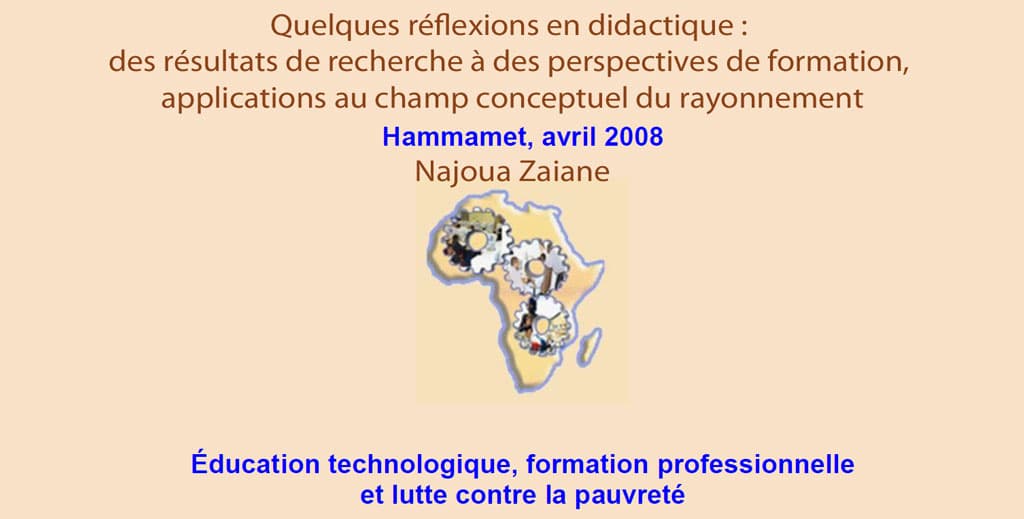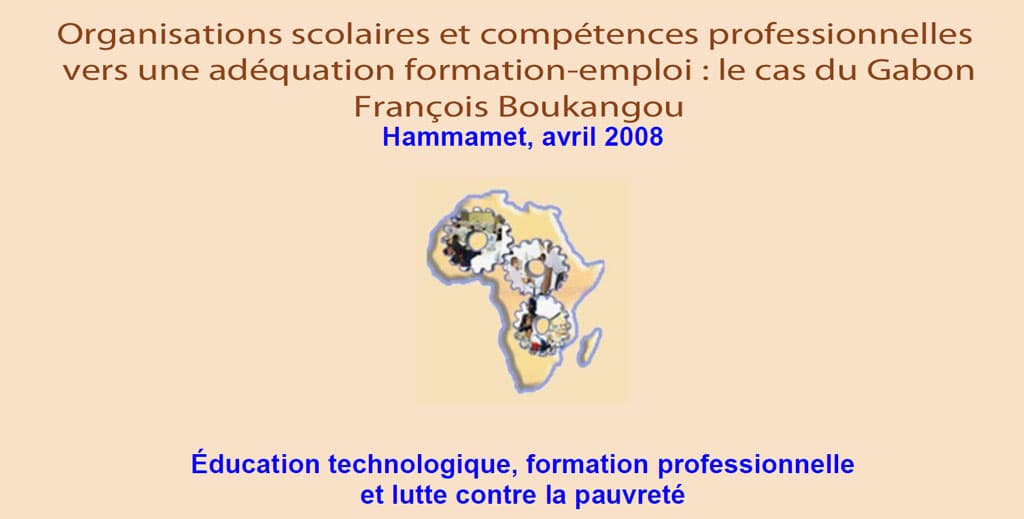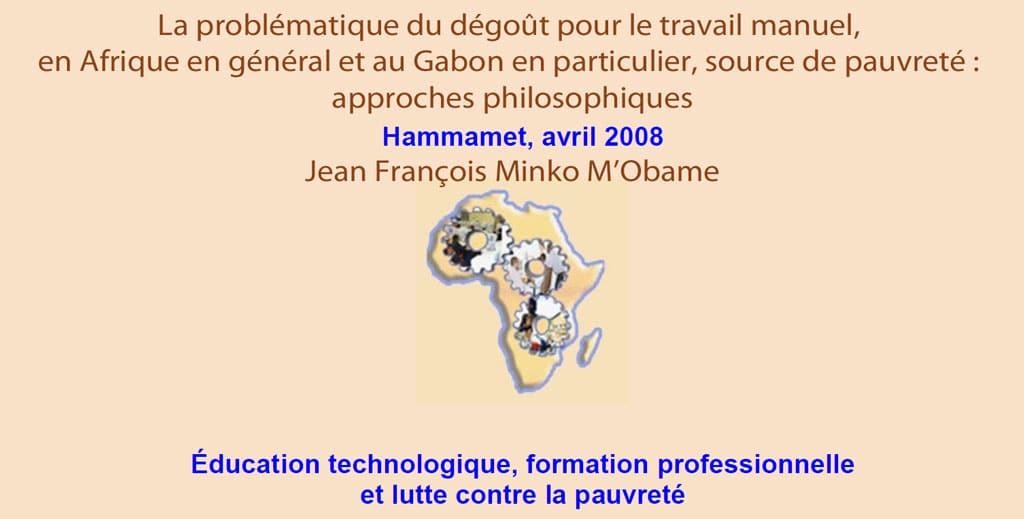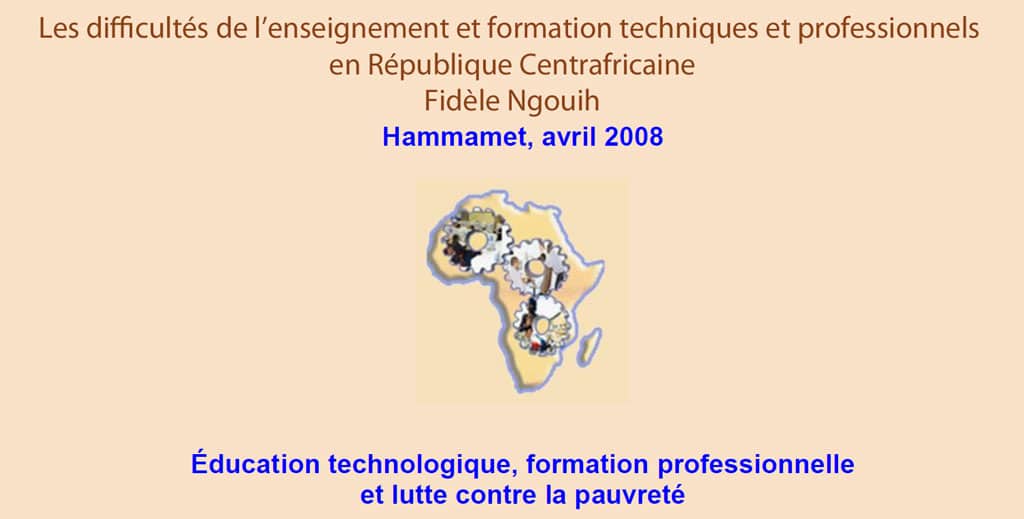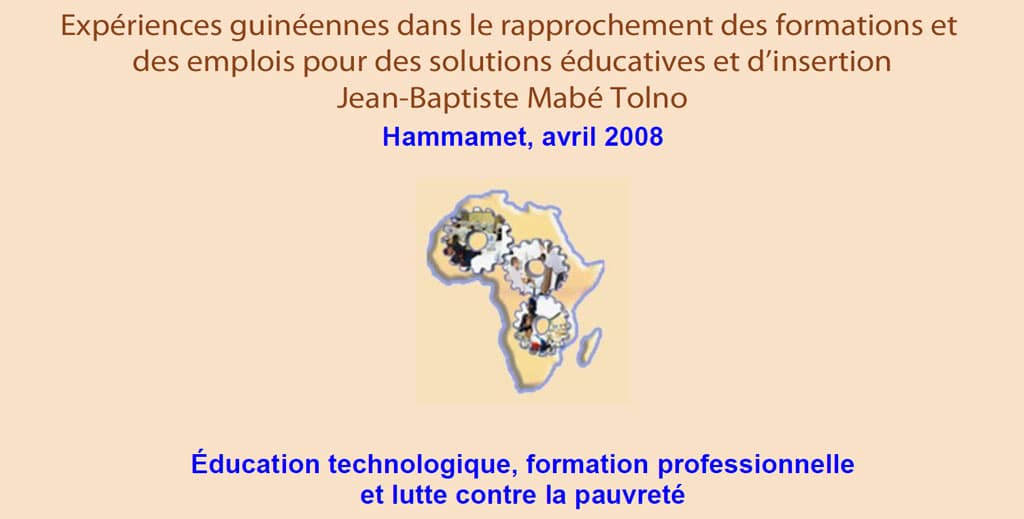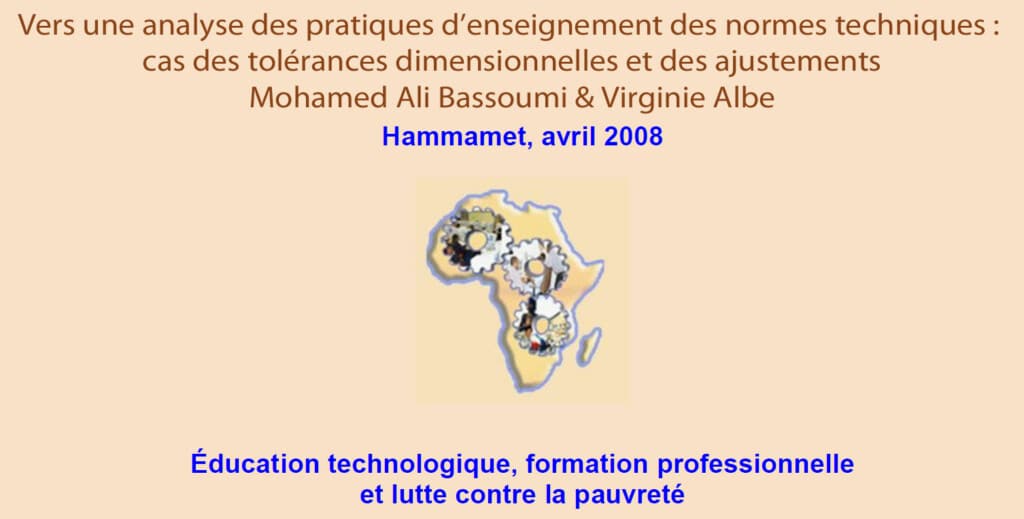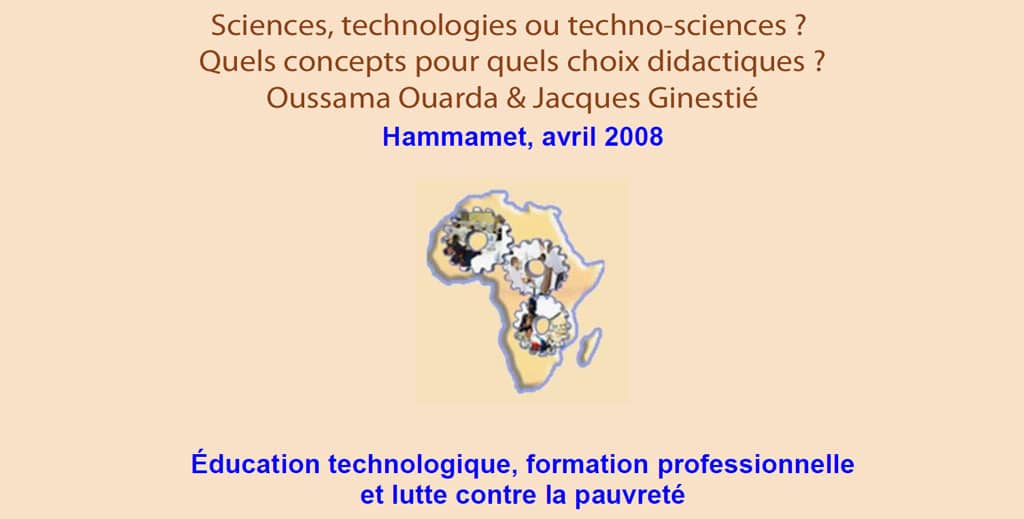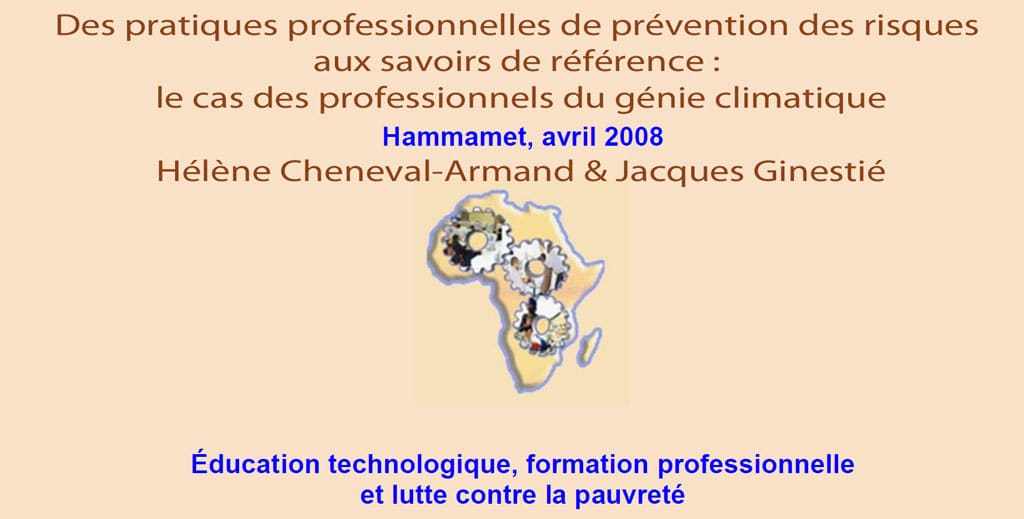Résultats d’enquête des difficultés d’étudiants en optique ondulatoire cas des interférences lumineuses
Intissar Romdhane
Summary
This article introduces the results of an investigation near Tunisian and French students (20-23 years), having received a teaching on the luminous interferences. We chose to clear and analyze the difficulties encountered by the students of university. We are interested in the types of reasoning used by the students, on the interpretation of the conditions of obtaining the phenomenon, and on the characterization of the space-time coherence of the light, like on the figures of interferences in partially coherent lighting. Among the ascertained difficulties, we find that the students do not use the principle of superposition of the waves. Moreover, the students tend to focus themselves on an aspect of the situation which is proposed to them, to support the perceptive elements, and encounter difficulties of reading the diagrams with parallel rays. Parallel to this investigation, we undertake a study of the handbooks of teaching. We center the analysis on the introduced interferential devices, the conditions of obtaining the interferences, their interpretation and the coherence of the light. Certain organizations and approaches in these handbooks can pose problems.
Introduction
Ce travail fait partie d’une recherche portant sur les interférences lumineuses (Romdhane, 2007). Nous avons remarqué qu’il existe de nombreux travaux sur les conceptions des apprenants en optique géométrique qui sont nécessaires pour l’étude des interférences comme la vision, la formation des ombres et des images, les réflexions et réfractions partielles (Goldberg & Mc Dermott, 1987 ; Kaminski, 1989 ; Singh & Butler, 1990).
En contrepartie, il existe peu de travaux sur les conceptions en optique ondulatoire tels que la diffraction par une ouverture, les interférences données par les fentes d’Young, la formation des images en éclairage cohérent en présence de diffraction ou d’interférences, la cohérence spatiale (Ambrose et al., 1999 ; Colin & Viennot, 2000 ; Maurines, 1999, 2000). Seuls quelques travaux traitent de la superposition des ondes (Wittmann et al., 1999 ; Maurines, 2003).
Face à ce constat, nous avons essayé de dégager et d’analyser les difficultés rencontrées par les étudiants lors de l’étude des interférences lumineuses dans l’enseignement supérieur. D’abord, nous présenterons brièvement les thèmes abordés dans les programmes d’enseignement suivis par les étudiants. Puis, nous préciserons les questions auxquelles nous avons cherché à apporter des éléments de réponse et la méthodologie que nous avons suivie. Ensuite, nous donnerons les résultats obtenus. Enfin, nous terminerons par quelques remarques sur les manuels d’enseignement.
Questions explorées
Les questions que nous avons explorées ont été déterminées d’une part par une étude des programmes d’enseignement, d’autre part par une analyse des difficultés des étudiants inspirée des recherches précédemment citées. Pour que notre travail puisse contribuer à améliorer l’enseignement des interférences, nous avons été amenées à nous intéresser à la façon dont les ondes sont enseignées dans ces deux pays.
En Tunisie, l’étude des interférences mécaniques et lumineuses est abordée pour la première fois en classe de terminale scientifique après l’étude de la propagation. A l’université, c’est au niveau de la quatrième année que l’optique ondulatoire est enseignée, l’optique géométrique l’étant en première année et la propagation des ondes mécaniques en troisième année. En classes préparatoires tunisiennes, l’optique géométrique est enseignée en première année. La physique des ondes mécaniques et l’optique ondulatoire sont par contre étudiées toutes les deux en deuxième année. En France, les interférences lumineuses ne sont plus abordées en classe de terminale scientifique depuis la rentrée 2002. Les ondes mécaniques et l’optique ondulatoire sont enseignées au niveau de la deuxième année de classes préparatoires et, en général, aussi, d’université. Les programmes tunisien et français des classes préparatoires suivent le même ordre thématique. Ils abordent d’abord les interférences lumineuses puis la diffraction. À l’université tunisienne où nous avons interrogé les étudiants, les cours suivent le même ordre.
Nous avons choisi de nous centrer sur les situations d’interférences à deux ondes. Nous nous intéressons aux conditions d’obtention des interférences lumineuses liées à la cohérence temporelle et à l’utilisation du principe de superposition des ondes. Nous avons cherché à apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : les étudiants savent- ils que deux sources de fréquences différentes ne peuvent pas donner des interférences et que deux lasers identiques même à faisceaux parallèles peuvent par contre produire des interférences ? Les étudiants savent-ils que l’existence des interférences ne dépend pas du déphasage relatif des sources, du moment que celui-ci est constant au cours du temps ? Les étudiants font-ils appel au principe de superposition des ondes spécifiques à l’optique ondulatoire dans le cas de trois sources secondaires ?
Méthodologie
Nous avons choisi d’utiliser essentiellement des questionnaires. Nous avons élaboré quatre questionnaires comportant plusieurs questions qualitatives. Ces questionnaires portant sur les thèmes abordés dans cet article ont été distribués à une population totale de 227 étudiants ayant reçu un enseignement sur les interférences lumineuses (des étudiants français en licence de physique et en préparation au CAPES de sciences physiques ; des étudiants tunisiens en deuxième année de classes préparatoires et en quatrième année de maîtrise de physique). Les étudiants n’ont pas eu à répondre à tous les questionnaires si bien que le nombre de réponses obtenues à une question varie de 47 à 76.
Résultats
Les étudiants et les conditions de cohérence temporelle des sources
Nous avons examiné cet aspect en proposant à quarante-sept étudiants un questionnaire proposant les deux situations décrites ci-dessous. Les questions concernent les conditions de cohérence temporelle des sources. Il était demandé aux étudiants, pour chacune des situations suivantes, (i) peut-on observer un phénomène d’interférences sur l’écran E ?
(ii) Si oui, représentez la figure observée. (iii) Expliquez pourquoi on observe ce phénomène en vous aidant d’un schéma si besoin est. (iv) Si non, qu’observe-ton sur l’écran et pourquoi ?

figure 1 questions concernant les conditions de cohérence temporelle des sources
Figure 1 : questions concernant les conditions de cohérence temporelle des sources
Rappelons tout d’abord qu’on parle d’interférences lorsqu’il existe des franges alternativement sombres et brillantes dans la zone commune à plusieurs faisceaux lumineux, en particulier pour deux faisceaux (figure 2). Pour expliquer ce phénomène, nous utilisons le modèle ondulatoire de la lumière qui s’appuie sur les concepts de champ et de phase, et sur le principe de superposition.

Figure 2 Les interférences lumineuses, alternance de franges sombres et brillantes
Figure 2 : Les interférences lumineuses, alternance de franges sombres et brillantes
Dans le cadre de ce modèle, en un point M de la zone commune, la fonction décrivant l’onde résultant de l’existence de deux ondes, émises simultanément par deux sources S1 et S2, est égale à la somme des fonctions décrivant les deux ondes prises séparément. La figure 3 explicite le cas de la superposition de deux ondes sinusoïdales. Les graphes représentent les fonctions décrivant ce qui se passe en un point M de l’espace au cours du temps lors de la propagation de l’onde émise par S1 seule (y1M(t)), par S2 seule (y2M(t)), par les deux (yM(t)). Le déphasage des deux ondes dépend de la différence de trajets entre le point d’observation M et les deux sources, donc du point M. Les ondes émises par les deux sources ayant la même amplitude mais étant en opposition de phase en M1, l’onde résultante en M1 a une amplitude nulle (interférence destructive : frange sombre). En un point M2 où les deux ondes composantes sont en phase, l’onde résultante sera décrite par une fonction sinusoïdale d’amplitude maximale (interférence constructive : frange brillante).
Deux faisceaux issus de deux sources ponctuelles donnent des interférences si les sources sont cohérentes. Cela signifie qu’elles ont la même fréquence et que le déphasage entre les deux sources est constant au cours du temps. Il n’existe pas de source ponctuelle de lumière rigoureusement monochromatique, autrement dit, il n’existe pas d’onde lumineuse sinusoïdale de durée infinie. La lumière émise par les sources dites quasi- monochromatiques est constituée d’une succession de trains d’ondes de même fréquence émis aléatoirement. La durée d’un train d’onde est d’autant plus grande que le spectre en fréquence de la lumière est étroit. Deux sources quasi-monochromatiques, identiques et indépendantes, peuvent donner lieu à des interférences si la durée des trains d’ondes est supérieure au temps de réponse du récepteur. Deux lampes à vapeur de sodium ne peuvent donner des interférences. Ce n’est que récemment, que des interférences ont pu être obtenues avec deux lasers (Hecht, 2002).

Figure 3 principe de superposition des champs yM(t) = y1M(t) + y2M(t)
Figure 3 : principe de superposition des champs yM(t) = y1M(t) + y2M(t)
Les résultats obtenus aux questions présentées dans la figure 1 sont regroupés dans le tableau 1. A la première situation mettant en jeu deux lampes monochromatiques non synchrones, 23% (N = 47) des étudiants répond de manière incorrecte en disant qu’on observe des interférences. Sur les 10 justifications fournies, les caractéristiques des deux sources ne sont pas comparées et tout semble se passer comme si une source unique pouvait donner des interférences : chaque longueur d’onde a son propre système de franges. Plusieurs étudiants (68%) répondent correctement en disant qu’il n’y a pas d’interférences mais peu justifient leur réponse. Quatre précisent que les sources ne sont pas synchrones et huit qu’elles sont incohérentes.
| Situation (N = 47) | Interférence | Pas d’interférence | Pas de réponse |
| 1. deux lampes non synchrones | 23% | correct : 68% | 9% |
| 2. deux lasers à faisceaux parallèles | correct : 23% | 37% | 40% |
Tableau 1 : résultats bruts en pourcentage
À la deuxième situation mettant en jeu deux lasers à faisceaux parallèles, seulement 23% (N = 47) des étudiants répond qu’il y a interférences. Deux étudiants le justifient par le fait qu’il y a une zone commune. Un nombre important d’étudiants (37%, N = 47) répond qu’il n’y a pas d’interférences car les rayons sont parallèles et ne se superposent pas. De plus, 40% d’entre eux ne répondent pas à cette question. Cette situation montre que les étudiants ont des difficultés à interpréter le schéma et à repérer l’existence d’une zone commune aux deux faisceaux parallèles ou le fait qu’un point de l’écran peut être l’intersection de deux rayons provenant des deux sources S1 et S2. On peut alors s’interroger sur la difficulté des étudiants à envisager l’existence d’interférences par superposition d’ondes planes ou quand les sources ne sont pas apparentes.
Les étudiants et les sources en opposition de phase
Nous avons demandé aux étudiants de décrire les modifications de la figure d’interférences observée sur un écran lorsque les deux sources sont en opposition de phase. En réalité, il existe toujours une figure d’interférences sur l’écran mais celle-ci est décalée par rapport à la figure donnée par deux sources en phase. 76% (N = 76) des étudiants répond que la figure d’interférences observée sur un écran et donnée par deux sources secondaires ponctuelles est modifiée lorsque les deux sources sont en opposition de phase. Cependant, 28% des étudiants dit qu’il n’y a pas d’interférence. Les justifications fournies font appel au fait que les sources ne sont pas cohérentes (4%) ou que les sources ne sont pas en phase (5%). Tout se passe comme si pour les étudiants, la différence de phase entre deux ondes était constante durant la propagation ou comme si le terme cohérence signifiait en phase. Parmi les 48% d’étudiants qui répondent qu’il y a des interférences lumineuses, seulement 25% mentionne un changement de la position des franges : la position des franges sombres qui vont prendre la place des franges brillantes (13%) ou les franges seront décalées (12%). Les autres étudiants précisent des changements erronés concernant soit une autre caractéristique géométrique (forme des franges 14%, écartement 11%, direction 4%), soit une caractéristique énergétique (luminosité 12%, contraste 13%). Un nombre moindre fait référence à la couleur (5%).
Les étudiants et le principe de superposition des ondes (cas de trois trous)
Les trains d’ondes émis par une source de lumière quasi-monochromatique étant émis de manière aléatoire, il est nécessaire de créer deux sources secondaires présentant un déphasage constant au cours du temps à partir d’une source primaire pour obtenir des interférences. Parmi les dispositifs qui créent des sources secondaires, il y a celui des trous d’Young. Il est constitué par deux petits trous percés dans un écran opaque. Comme la diffraction de la lumière ne pouvant être négligée au niveau de chacun des trous (figure 4), ces derniers se comportent comme deux sources de lumière émettant dans toutes les directions.
Quand la source primaire est ponctuelle (cohérence spatiale totale), les trous présentent un déphasage constant au cours du temps. Les franges d’interférence sont rectilignes, équidistantes et perpendiculaires au plan de la figure. Lorsque la source ponctuelle éclaire non pas deux trous mais trois (situation 1 de l’encadré 4), nous observons une figure d’interférences différente de celle obtenue avec deux trous. Si les franges d’intensité maximale sont aux mêmes endroits que dans le cas de deux trous, il y a, en plus, entre deux franges consécutives, une frange brillante d’intensité plus petite entourée de deux franges sombres. Pour interpréter la répartition de l’intensité lumineuse sur l’écran, on utilise d’abord le principe de superposition des ondes qui conduit à additionner les fonctions associées aux ondes issues de chacun des trous. Ensuite, on prend la valeur moyenne temporelle du carré de la fonction somme.
À la question mettant en jeu trois trous, 23% (N = 57) des étudiants ne répond pas. Pour d’autres (23%), ils donnent une réponse incorrecte en disant que la figure d’interférences n’a pas changé. Pour 9% d’entre eux, ce n’est qu’une figure d’interférence à trois trous. Quelques justifications (4%) sont proches de celles obtenues par Ambrose : la figure d’interférences semble être la superposition des figures de diffraction produites par un trou, chaque source produit son propre système d’interférence. 54% des étudiants répondent que la figure d’interférences a changé. Il n’y a que 7% des étudiants qui disent qu’il existe un phénomène d’interférence avec augmentation du nombre.

igure 3 Les étudiants et les trous d’Young en lumière quasi-monochromatique
Figure 3 : Les étudiants et les trous d’Young en lumière quasi-monochromatique
À la question mettant en jeu trois trous, 23% (N = 57) des étudiants ne répondent pas. Pour d’autres (23%), ils donnent une réponse incorrecte en disant que la figure d’interférences n’a pas changé. Pour 9% d’entre eux, ce n’est qu’une figure d’interférence à trois trous. Quelques justifications (4%) sont proches de celles obtenues par Ambrose : la figure d’interférences semble être la superposition des figures de diffraction produites par un trou, chaque source produit son propre système d’interférence. 54% des étudiants répondent que la figure d’interférences a changé. Il n’y a que 7% des étudiants qui disent qu’il existe un phénomène d’interférence avec augmentation du nombre de franges. 40% des étudiants considèrent que l’intensité augmente. On rencontre trois types de raisonnement qui ne s’appuient pas sur le principe de superposition des ondes mais sur une règle d’addition des intensités des figures d’interférences :
- la figure correspondant aux trois trous semble être la superposition des figures produites par chaque trou I=I1+I2+I3. On retrouve ici un type de justification également fourni par les étudiants qui disent que la figure n’a pas changé.
- la figure correspondant aux trois trous correspond à la superposition de deux figures produites par deux trous : superposition de deux systèmes d’interférences l’un formé par S3 et S1 et l’autre par S3 et
- la figure correspondant aux trois trous est une figure d’interférences à deux trous à laquelle on ajoute la figure due à un trou : troisième trou introduit un autre système d’interférence.
Quelques remarques sur les manuels d’enseignement
L’examen des manuels d’enseignement révèle que les approches choisies sont diverses et ne facilitent pas l’apprentissage des interférences lumineuses. Ainsi, en ce qui concerne la définition des interférences lumineuses, certains manuels n’utilisent qu’un registre mathématique et ne s’appuie sur aucune situation expérimentale (Charmont, 2000). Comme donner du sens en physique suppose d’établir des liens entre les phénomènes et les modèles, il nous semble préférable de partir d’une situation expérimentale. En ce qui concerne les conditions d’obtention des interférences, certains manuels ne les mentionnent pas lors du premier cours (Quaranta, 1998). Le phénomène est étudié complètement dans le cas de la cohérence totale et ce n’est qu’ensuite que les conditions d’obtention sont abordées. Comme cela pourrait renforcer l’idée qu’il suffit d’avoir deux sources ponctuelles monochromatiques pour avoir des interférences, il nous semble préférable d’accompagner la définition des interférences lumineuses de la donnée des conditions d’obtention. Il nous semble aussi souhaitable d’utiliser différentes conditions expérimentales et de décrire à chaque fois qualitativement la figure d’interférences. Cela permettrait de dégager les différentes grandeurs physiques intervenant dans une situation donnée et les liens qu’elles entretiennent ou n’entretiennent pas. De plus, les interférences par superposition d’ondes planes ne sont pas abordées avant l’étude des lames minces. Ceci pourra poser problème comme on l’a vu plus loin. En ce qui concerne l’interprétation des conditions d’obtention, certains manuels ne mentionnent pas le modèle du train d’onde (Martin, 1998). La plupart de ceux qui l’introduisent ne le font pas fonctionner pour expliquer pourquoi l’état d’interférences en un point donné de l’espace est constructif ou destructif.
Conclusion
La première tendance de raisonnement, spécifique des interférences lumineuses, concerne leurs conditions d’obtention. Les étudiants interrogés savent qu’il est nécessaire d’avoir deux sources pour avoir des interférences. Cependant, il n’est pas nécessaire pour eux qu’elles soient obtenues à l’aide d’un dispositif interférentiel : il suffit qu’elles soient ponctuelles et identiques. Par contre, pour eux, il est nécessaire que les sources soient en phase : deux sources en opposition de phase ne peuvent pas produire des interférences. Pour la figure d’interférences produites par trois trous, elle est comprise par certains étudiants comme la superposition des figures produites par chaque trou. Il semble que pour certains étudiants, la situation à deux sources soit la situation prototypique d’interférences si bien qu’ils tentent de s’y ramener : la figure d’interférences obtenue avec trois trous est ainsi conçue comme la superposition de figures produites par deux sources prises deux à deux, ou bien comme la superposition de la figure produite par deux trous et de la figure produite par un trou.
Bibliographie
Ambrose B.S., Schaffer P.S., Steinberg R.N. & Mc Dermott L. (1999). An investigation of student understanding of single-slit diffraction and double slit-interference. American Journal of Physics, vol. 67, n°2, pp.146-155.
Charmont P. (2000). Leçons de physique. Paris, Dunod.
Colin P. (1999). Deux modèles dans une situation de physique : le cas de l’optique ; difficultés des étudiants, points de vue des enseignants et proposition pour structurer des séquences d’enseignement. Thèse, Université Paris 7.
Colin P. & Viennot L. (2000). Les difficultés d’étudiants post-bac pour une conceptualisation cohérente de la diffraction et de l’image optique. Didaskalia, n°17, pp. 29-54.
Goldberg F.M. & Mc Dermott L. (1987). An investigation of students understanding of the real image formed by a converging lens or concave mirror. American Journal of Physics, vol. 55, n°2, pp. 108-119.
Hecht E. (2002). Optics. United States of America, Addison-Wesley.
Kaminski W. (1989). Conceptions des enfants (et des autres) sur la lumière. Bulletin de l’union des physiciens, n°716, pp. 973-996.
Martin G. (1998). Panorama sur l’optique ; de l’optique géométrique à l’optique quantique. Paris, Nathan.
Maurines L. (1997). Raisonnement spontané sur la diffraction. In actes du sixième séminaire national de recherche en didactique des sciences physiques, Lyon, pp. 77-95.
Maurines L. (1998). Les élèves et la propagation des signaux sonores. Bulletin de l’Union des Physiciens, n°800, pp. 1-22.
Maurines L. (1999). La propagation des ondes en dimension 3 : analyse des difficultés des étudiants quant au modèle géométrico-ondulatoire. Didaskalia, n°15, pp. 87-122.
Maurines L. (2000). Les étudiants, la diffraction de Fraunhofer et la formation des images en éclairage cohérent. Didaskalia, n°17, pp. 55-99.
Maurines L. (2003). Analyse des difficultés des étudiants à propos des concepts de phase et de surface d’onde, du principe de Huygens. Didaskalia, n° 22, p. 9-39.
Quaranta L. (1998). Introduction à l’optique. Paris, Masson.
Romdhane I. (2007). La cohérence de la lumière et les interférences lumineuses. Raisonnements des étudiants et difficultés d’ordre historique. Thèse de doctorat. Université Paris 7.
Singh A. & Butler P.H. (1990). Refraction: conception and knowledge structure. International Journal of Science Education, vol. 12, n°4, pp. 492-442.
Wittmann M. C., Steinberg R.N. & Redish E.F. (1999). Making sense of how students make sense of mechanical waves. The Physics Teacher, n°37, pp. 15-21.
Résumé
Cet article présente les résultats d’une enquête auprès d’étudiants tunisiens et français (20-23 ans) ayant reçu un enseignement sur les interférences lumineuses. Nous avons choisi de dégager et d’analyser les difficultés rencontrées par les étudiants d’université. Nous nous intéressons aux types de raisonnements utilisés par les étudiants, sur l’interprétation des conditions d’obtention et sur la caractérisation de la cohérence spatio-temporelle de la lumière ainsi que sur les figures d’interférences en éclairage partiellement cohérent. Parmi les difficultés dégagées, nous retrouvons que les étudiants n’utilisent pas le principe de superposition des ondes. De plus, les étudiants tendent à se focaliser sur un aspect de la situation qui leur est proposée, à favoriser les éléments perceptifs, et rencontrent des difficultés à lire les schémas avec des rayons parallèles. Parallèlement à cette enquête, nous entreprenons une étude des manuels d’enseignement. Nous centrons l’analyse sur les dispositifs interférentiels introduits, les conditions d’obtention des interférences, leur interprétation et la cohérence de la lumière. Certaines organisations et modes d’approches de ces manuels peuvent poser problèmes.