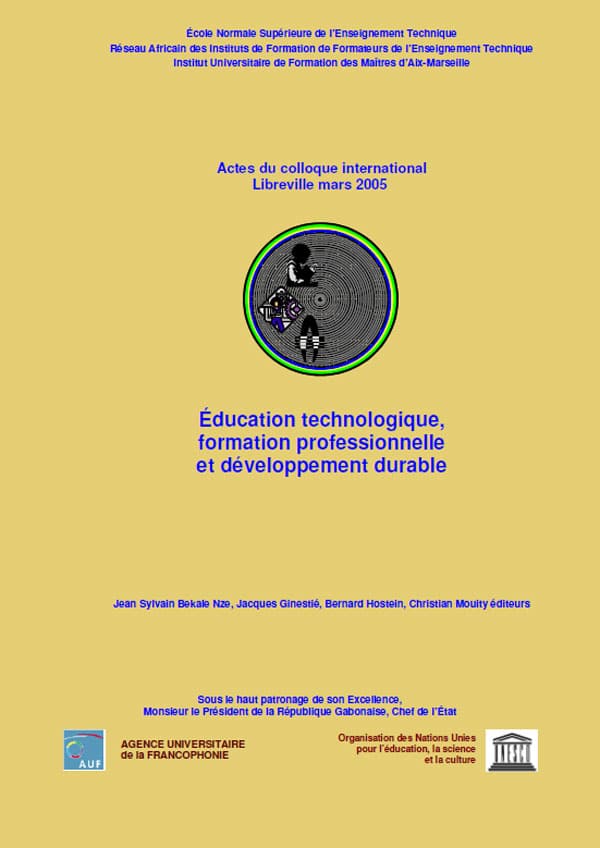DE L’IMPÉRATIF COMMUNICATIONNEL DANS LA DÉFINITION DES CONTENUS DE FORMATION – MARIE-ZOÉ MFOUMOU TAKING IN ACCOUNT COMMUNICATION WITHIN THE TRAINING CONTENTS DEFINITION LIBREVILLE2005
DE L’IMPÉRATIF COMMUNICATIONNEL DANS LA DÉFINITION DES CONTENUS DE FORMATION – MARIE-ZOÉ MFOUMOU
TAKING IN ACCOUNT COMMUNICATION WITHIN THE TRAINING CONTENTS DEFINITION
Assistante des Lettres et des Sciences humaines, Doctorante – Université Omar Bongo – Libreville, Gabon – Centre de Recherche sur les Médiations, Université de Metz – Metz, France
SUMMARY
In the Sixties, the generally widespread opinion consisted in saying that education played a significant role in the socio-economic development of a country. UNESCO contributed to the installation of a programme of basic education for all. With regard to the African countries, estimating that they needed to constitute themselves their human resources, material and financial, UNESCO convened in May 1961, a conference of the African States with Addis-Ababa, in order to make an inventory of their educational needs and to establish an action plan for the years to come. But more than 40 years after this conference, the situation of the vocational training remains catastrophic in sub-Saharan Africa (impertinence of the dies, inefficiency of the technical aid, difficulties of organizing the education systems, inefficiency of the formations…). The reasons of this catastrophe are to seek not only in the obsolescence of the equipment or then in the ignorance of the stakes of the vocational training for economies under development, but more especially in the incapacity of the actors of this device of formation to communicate and with tending towards the collegial structure of their objectives of formation, when it is known that from now on, and whatever the field, the communication is presented in the form of a requirement of rationality.
INTRODUCTION
L’école forme non seulement à l’insertion professionnelle, mais elle forme aussi l’homme social ou l’humain. Trois missions lui sont donc assignées : l’accès à la culture, la formation du citoyen et la préparation au monde professionnel. Seulement, les différentes réformes et les discours produits sur la formation et l’école semblent privilégier les deux premières missions, en insistant sur l’enseignement général qu’ils estiment être le fondement d’une assimilation rationnelle des connaissances. C’est ce qu’on observe, en tout cas, dans les pays industrialisés où les politiques mises en œuvre témoignent bien de l’intérêt accordé à l’éducation et à la formation des jeunes.
Ces pays étant les colonisateurs des États africains, on observe une influence de leurs modèles sur les modèles africains11 qui tendent à devenir des copies mal reproduites avec toutes les conséquences que cela engendre au niveau des performances, du rendement des jeunes diplômés et à celui, plus général, de l’adéquation entre les formations et les emplois. L’inadéquation entre formation et emploi est accentuée, en Afrique subsaharienne, par la multiplicité des tutelles et l’absence de concertation entre tutelles, d’une part, et entre formateurs et utilisateurs potentiels d’autre part. Or, les pays africains semblent oublier que le développement durable de leurs économies repose, en partie, sur la qualité des hommes issus de leurs systèmes éducatifs et sur la capacité de ceux-ci à mettre en pratique les savoirs théoriques assimilés lors de la formation initiale ; l’activité évoluant au gré de la technologie, il est nécessaire que ces savoirs soient réactualisés. Mais cette réactualisation ne saurait se faire si les politiques éducatives et les objectifs de formation ne sont pas clairement définis et surtout si l’offre de formation n’est pas professionnalisée. La présente communication qui s’inspire de notre expérience de formatrice du tertiaire, des rapports consultés12, des enquêtes et entretiens réalisés dans le cadre de notre recherche doctorale, souhaite soutenir l’hypothèse selon laquelle l’impératif communicationnel serait une solution à la définition des contenus de formation adaptés aux besoins des économies africaines. Après avoir présenté les enjeux de la formation professionnelle pour les pays qui aspirent à se développer, nous dirons la situation dans laquelle se trouvent actuellement les systèmes ou les dispositifs de formation des pays africains. Cette dernière analyse met en évidence les lacunes communicationnelles dans l’enseignement technique et professionnel. C’est pourquoi, nous pensons que des échanges réguliers entre les acteurs de ce secteur de l’éducation seraient un début de solution à l’inadéquation des contenus de formation.
12 Notamment le rapport sur la formation professionnelle dans les pays de la zone de solidarité, adopté le 8 octobre 2001 par le groupe de travail des services de la Primature française, présidé par André Delluc ; le rapport sur la politique sectorielle de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, élaboré en février 2002 par le Ministère de l’enseignement technique, de la formation professionnelle, de l’alphabétisation et des langues de la République du Sénégal, les rapports de François Orivel, enseignants à l’Université de Bourgogne et chercheur au CNRS sur l’éducation et la formation en Afrique et dans le monde, ainsi que les rapports établis entre 1993 et 1996 par le Comité ad hoc pour la réforme de l’enseignement technique et professionnel (CARETP) du Gabon et d’autres analyses faites sur la formation en Afrique subsaharienne.11 Le Gabon et le Sénégal en sont deux exemples.
LES ENJEUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES PAYS AFRICAINS
A propos de l’éducation et de la formation en Afrique de manière générale, deux observations méritent d’être faites ici. La première concerne la période avant les indépendances, la deuxième concerne le début des indépendances. Avant les années 60, il était communément admis et reconnu que l’éducation jouait un rôle important dans le développement socio-économique d’un pays. L’Unesco qui, depuis sa création en 1945, avait retenu, parmi ses principaux objectifs, la reconstruction scientifique et culturelle des pays dévastés par la deuxième guerre mondiale, a adopté un vaste programme d’éducation de base et amorcé un projet d’extension de l’enseignement dans ces pays.
En ce qui concerne les pays africains, l’Unesco a estimé qu’il fallait les aider à constituer eux-mêmes leurs capitaux, leurs installations et leurs cadres, ce qui devait leur permettre d’élever leur niveau intellectuel. C’est pourquoi une conférence des États africains a été convoquée en mai 1961 à Addis- Abeba en Éthiopie, afin de faire l’inventaire de leurs besoins en matière d’enseignement et établir, pour les années à venir, un programme d’action répondant à ces besoins. Mais, plus de quarante ans après cette conférence et malgré les moyens énormes consacrés à l’éducation, les pays africains restent parmi les plus pauvres de la terre même si l’éducation semble avoir beaucoup amélioré les conditions de vie de certaines populations. Par ailleurs, on observe que le type d’éducation hérité de la colonisation s’avère désormais inadapté aux contextes socio-économique et culturel de l’Afrique noire subsaharienne. Le début des années 60 va pourtant constituer une étape importante dans l’histoire des systèmes éducatifs des pays au Sud du Sahara qui sortent de la colonisation et aspirent au développement économique et social. L’éducation va se présenter alors comme le moyen le plus sûr pour y arriver.
Malgré la conférence d’Addis-Abeba, la situation de l’école africaine reste catastrophique
En Afrique, la Conférence d’Addis-Abeba va fixer les grandes orientations de l’éducation. Malgré les résolutions prises au cours de ces assises, on constate aujourd’hui qu’au même titre que l’économie, la situation de l’école africaine demeure « catastrophique ». Les taux de déperditions sont élevés et les formations proposées sont organisées de façon non rentable, quand elles ne répondent pas aux besoins économiques du pays, freinant ainsi leur croissance. A propos de la relation entre éducation et croissance dans les pays en voie de développement, Jean-Claude Balmès (2003 : 5-6) de l’Agence française de développement fait remarquer que « les études prospectives sur les différentes régions du monde en développement ont clairement établi que la croissance ne peut s’installer de façon durable sans une production préalable suffisante de capital humain. L’éducation est un moteur de croissance économique : elle conditionne la modification des comportements sociaux et des modes de production, elle est source de productivité et de compétitivité »13. L’éducation a « des effets positifs incontestables sur l’environnement et la gestion des ressources naturelles, la démographie, l’hygiène et l’état sanitaire. Elle est une condition du développement durable » précise l’auteur.
De la nécessité de se recentrer sur la relation formation/emploi
Secteur spécifique du système de l’éducation et de la formation, la formation professionnelle et technique (FPT), ouverte sur le monde du travail et de l’emploi, est au cœur de la problématique du développement économique et social des pays en voie de développement. De nombreux projets nationaux de réformes des systèmes éducatifs mettent en exergue l’impérieuse nécessité de recentrer les systèmes éducatifs sur la relation formation-emploi, sur l’insertion des jeunes dans la vie sociale et professionnelle et sur l’accompagnement du développement économique endogène des pays. C’est aussi le sens des recommandations des principales institutions internationales qui souhaitent que la formation professionnelle et technique puisse fonder sa légitimité par la qualité de son lien étroit avec le développement socio-économique car, la relation éducation productivité du travail dépend très fortement de la politique éducative mise en place tout comme l’adéquation des qualifications aux emplois dépend de la qualité du système éducatif. Malgré ces recommandations, la situation des dispositifs de formation des pays en voie de développement ne semble pas évoluer.
13 Balmès J-C., 2003, “ L’agenda international de l’éducation pour tous”, pp. 5-11, in L’éducation, fondement du développement durable en Afrique,. Bauchet P., Germain, P., (dir.). Paris, PUF, 169 pages.
LA RÉALITÉ DES SYSTÈMES OU DISPOSITIFS ÉDUCATIFS AFRICAINS
Tout système éducatif se doit d’une part de transmettre des connaissances aux niveaux éducatifs initiaux, et de préparer à la vie professionnelle aux niveaux terminaux en se référant, pour cela, à la dimension exogène qu’est le marché du travail. Il est en effet souhaitable que le système éducatif produise des diplômés en quantité et, surtout, en qualité afin de répondre, dans la mesure du possible, à la demande de l’économie. Cependant, les analyses faites et les rapports produits14 dressent un bilan alarmant des dispositifs de formation mis en place dans la plupart des pays africains.
La mission initiale de l’école africaine est devenue obsolète
Héritée de la colonisation, l’école en Afrique était essentiellement orientée vers l’enseignement général. Sa mission était, entre autre : de doter l’administration coloniale de collaborateurs lettrés pour servir efficacement de relais entre elle et le reste de la population analphabète ; de former les cadres de la Fonction publique pour l’administration des Républiques naissantes. A cet égard, l’école a bien rempli sa mission. Tant et si bien qu’elle est devenue le seul lieu d’excellence. En dépit des efforts financiers des gouvernements, on constate un immobilisme dont on peut énumérer quelques causes : les qualifications et les formations proposées aux jeunes ne correspondent plus aux besoins du marché de l’emploi, à l’esprit d’entreprise et de créativité. La fonction publique était considérée comme unique voie de réussite sociale. Aujourd’hui, cet aspect de sa mission est obsolète, car les fonctions publiques sont saturées : elles ont trop d’agents par rapport aux besoins, alors mêmes que ces pays sont soumis à un programme d’ajustement structurel par la Banque mondiale et le Fond monétaire international. Globalement, l’école continue de fonctionner sur ces bases, malgré les évolutions structurelles et socio-économiques. Actuellement, les établissements de formation continuent de recruter, par orientation spécifique des élèves, à divers niveaux de l’enseignement général pour des filières initialement décalquées du système français dont les diplômes ont été le plus souvent maintenus : certificats d’aptitudes professionnelles (CAP), brevets d’études professionnelles (BEP), brevets de techniciens supérieurs (BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), etc. Ayant peu tenu compte, lors de leur création, des réalités sociales et économiques locales, la pertinence de ces filières devient limitée.
La faible employabilité des diplômes
L’employabilité des diplômés est faible non seulement en raison de l’étroitesse du marché du travail dans le secteur moderne auxquels ils sont destinés, mais aussi à cause de l’inadaptation et de la rigidité des curricula. Les formations sont coûteuses, alors que leur rendement, interne et externe demeure faible. De plus, les élèves n’acquièrent qu’une faible technicité, l’enseignement demeurant largement théorique et la pratique limitée, faute de relations avec les entreprises (stages ou alternance). L’enseignement dispensé dans la plupart des pays africains est encore largement académique, les enseignants étant peu préparés à l’ouverture sur le monde du travail. Enfin, l’implantation spatiale des formations ne correspond pas toujours à celle du tissu économique et social local, c’est pourquoi la demande reste forte dans les spécialités auxquelles l’école ne forme pas alors qu’elle continue de former à celles qui sont déjà saturées sur le marché de l’emploi. Prenant le cas du Gabon, nous citerons le rapport Mignot (2002) sur l’enseignement supérieur au Gabon qui révèle, à propos des besoins prioritaires de l’économie gabonaise, qu’« avec la récession, le chômage s’est, bien entendu, accru (il touche 20% de la population active). Paradoxalement, cependant, l’offre d’emplois émanant du secteur privé est, selon les statistiques disponibles (qui sont d’interprétation délicate) et de l’avis des chefs d’entreprise, loin d’être entièrement satisfaite, tout spécialement pour ce qui concerne les métiers techniques (les faibles performances du système d’enseignement supérieur en ce domaine rendent, d’ailleurs, l’affirmation tout à fait vraisemblable). Par ailleurs, même la fonction publique ne réussit pas à recruter tous les agents dont elle a besoin : l’enseignement de base manque encore de beaucoup de compétences, notamment dans les disciplines scientifiques et techniques (là encore les faibles performances du système d’enseignement supérieur en ces domaines expliquent les lacunes constatées) ». Il y a là comme un problème de coordination des actions de formation et un gaspillage des ressources puisqu’on forme pour des spécialités dont l’économie n’a pas besoin et pas assez pour les filières dont elle a besoin.14 A titre d’exemples, nous citerons : 1/ Le rapport sur la politique sectorielle de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, élaboré en février 2002 par le Ministère de l’enseignement technique, de la formation professionnelle, de l’alphabétisation et des langues de la République du Sénégal. 2/ Les rapports produits entre 1993 et 1996 par le Comité Ad hoc pour la réforme de l’Enseignement Technique et Professionnel (CARETP) du Ministère de l’éducation nationale du Gabon. 3/ Le rapport d’Alain Mignot sur « L’enseignement supérieur au Gabon », novembre 2002. 4/ Les rapports issus des stages effectués à la Confédération Patronale gabonaise (CPG) par des étudiants de l’école nationale supérieure de secrétariat. 5/Les actes du colloque sur « L’éducation, fondement du développement durable en Afrique » tenu en novembre 2002, et publiés aux Presses universitaires de France en 2003. 6/ Le Rapport sur « La coopération française en matière de formation professionnelle dans les pays de la zone de solidarité prioritaire », produit par le groupe de travail des services de la Primature française, présidé par André Delluc et adopté le 8 octobre 2001. 7/ Conférence donnée par François Orivel (Directeur de recherche à l’Iredu du CNRS- Université de Bourgogne) à Paris le 23 mai 2002 sur le thème « Les inégalités internationales en matière d’éducation ».
Une assistance technique inadéquate, d’où son inefficacité
Lors des indépendances africaines, dans les années 60, la relation formation-emploi n’était pas en France un souci majeur. Bien au contraire, on a profité de cette période de plein emploi pour intégrer l’enseignement technique dans l’enseignement secondaire et marginaliser l’enseignement professionnel (les centres d’apprentissage deviendront alors des collèges d’enseignement technique). Le recrutement en seconde dans les lycées techniques et la création des baccalauréats techniques décidée à cette occasion n’ont pas permis l’acquisition d’une qualification professionnelle utilisable immédiatement, les nouveaux baccalauréats constituant le passage obligé pour la poursuite des études (en instituts universitaires de technologie ou en sections de techniciens supérieurs principalement). Les programmes de ces établissements mettent davantage l’accent sur la théorie que sur la pratique : sans relation avec les entreprises pendant leur formation, les titulaires ne se professionnalisent souvent qu’après embauche. Aucune politique de formation continue n’était à l’ordre du jour. Comme on a pu le constater dans les pays africains, c’est la création et le soutien de ces nouveaux lycées techniques recrutant en seconde, de même statut et de même mode d’organisation interne que les lycées d’enseignement général qui a constitué l’axe central de la coopération française. Ce modèle d’enseignement technique qui correspondait à une société de forte croissance industrielle et de plein emploi a été adopté tel quel en Afrique où il a produit un grand nombre de chômeurs diplômés. Son inadéquation aux besoins d’une économie faiblement industrialisée dont le niveau moyen d’instruction des travailleurs potentiels est très faible, était évidente. Dans le même temps, plusieurs pays poursuivent la préparation du CAP dans les collèges d’enseignement technique ou dans les centres de perfectionnement comme en Côte d’Ivoire dans les années 70 et au Gabon jusqu’à une période assez récente. La répartition de compétences en matière de formation professionnelle entre les ministères du travail et de l’éducation nationale, a également été reproduite en Afrique, posant des problèmes de tutelles souvent plus concurrentes que complémentaires.
Ce modèle exporté a été animé par un important dispositif de coopérants fonctionnaires de l’Éducation nationale (plus de 2000 en 1980 dans l’enseignement technique), tous utilisés en substitution. Partant du principe « qu’en Afrique c’était comme en France », ces enseignants étaient expatriés sans préparation (et sans suivi…) et réintégrés sans problème à leur retour. Cette facilité administrative n’a pas permis de recruter d’autres profils de contractuels, de professionnels par exemple, plus qualifiés pour les relations avec les entreprises. Cette présence massive de coopérants n’a pas aidé à la promotion et à la responsabilisation des formateurs africains, d’autant plus qu’elle n’a longtemps, pas été associée à un programme de formation de formateurs. Ce statut de détachement sans suivi a aussi été la cause d’une coupure de ces personnels avec les évolutions de l’enseignement technique et professionnel en France, privant ainsi l’ancien ministère de la coopération d’éléments d’inspiration pour faire évoluer ses politiques. C’est l’une des causes de l’absence d’une politique sectorielle adaptée. L’urgence de la consolidation initiale des États a occulté la concertation, la communication et les analyses préalables nécessaires à la mise en place de dispositifs aussi lourds, ce qui a provoqué une certaine inertie des dispositifs de formation car, cette coopération « d’administration à administration » n’a tenu compte ni de la prise de conscience progressive des erreurs stratégiques de départ, exprimées par de nombreuses personnalités africaines ou experts étrangers, ni des évolutions importantes de la formation professionnelle en France (loi Delors en 71, mécanismes de financement par taxation des entreprises, etc.) correspondant à la montée en puissance de la relation formation-emploi. La plupart des États africains et surtout d’Afrique subsaharienne se sont contentés de reproduire des programmes de formation pour justifier l’utilisation de leurs enseignants sans se soucier véritablement des conséquences qu’un tel plagiat aurait sur la qualité des produits issus de leurs systèmes éducatifs et sur le rendement des différentes organisations.
Une relation formation/emploi difficile à établir
Préconisée tant par les organismes publics des formations que par les organisations professionnelles, cette relation a du mal à se mettre en place ou n’existe que de façon formelle à travers des comités inefficaces. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet immobilisme : le statut global de la formation professionnelle et de ses établissements n’a pas la souplesse indispensable pour entretenir la concertation permanente nécessaire d’une part, et d’autre part, les organisations professionnelles elles-mêmes n’ont pas les capacités nécessaires en ingénierie de formation leur permettant d’exprimer clairement leur besoins.
L’éclatement des tutelles et des structures de formation
L’offre de formation professionnelle de la plupart des pays est faite de plusieurs composantes qui peuvent être liées au ministère de l’Éducation nationale, à celui de l’Enseignement supérieur, au ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, mais aussi au secteur privé ou aux entreprises. La cohérence entre ces différentes modalités est loin d’être assurée. Un tel éclatement des tutelles autorise une multitude des centres de décision et engendre des problèmes de gouvernance tel qu’Alain Mignot (2002 : 8) l’observe dans le cadre de l’enseignement supérieur au Gabon. Il dit : « L’enseignement supérieur et la recherche dépendent d’un ministère distinct de celui de l’éducation nationale : le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique (MESRIT). Ce ministère comprend, outre les conseillers attachés au ministre (16) et le secrétaire général, quatre directions […]. Une telle structure trahit, en dépit de la très haute qualité de certains des membres qui l’animent, la faible capacité du ministère à impulser une véritable politique de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Ainsi, la multiplicité des centres de décision se révèle être un handicap au bon fonctionnement des dispositifs de formation surtout dans un contexte de faible communication où les systèmes d’information sont encore déficitaires. Lorsqu’ils existent, ils demeurent archaïques, fonctionnant toujours selon un mode manuel. Par ailleurs, les compétences acquises dans les différents lieux de formation (surtout privés) ne sont que rarement reconnues, en dehors du système où elles ont été produites.
La dégradation de la qualité de la formation
Cette dégradation est appréciable à deux niveaux, au niveau des « inputs » pédagogiques et au niveau des résultats. Au niveau des « inputs » pédagogiques, on assiste actuellement en Afrique subsaharienne à une diminution des inputs non salariés, c’est-à-dire de tout ce qui est autre que l’enseignant, c’est-à-dire une diminution de la disponibilité de manuels scolaires, des matériels de laboratoires, des efforts pour entretenir les bâtiments, des budgets pour acquérir du mobilier, et ce, à tous les niveaux d’études. Au niveau du supérieur cette dégradation n’est pas moins grave, on y constate des difficultés d’approvisionnement des bibliothèques en ouvrages récents, de financement des budgets de recherche, de réapprovisionnement en équipement micro-informatique, etc. Au niveau des résultats, la dégradation est plus difficile à mettre en évidence à cause du manque d’indicateurs fiables. Si on se réfère à l’indicateur de résultat aux examens, on se rend compte que le taux de succès au Baccalauréat a considérablement baissé dans un très grand nombre de pays. Le problème, ici, est qu’il n’est pas toujours facile d’interpréter de façon précise les causes de cette baisse. Une autre façon de mesurer les résultats c’est de faire passer aux élèves des tests de connaissance standardisés. Ce qui permet de mesurer les compétences acquises par les élèves ; cependant, très peu de tests, de ce type, sont réalisés. Par ailleurs, aucune étude chronologique comparant, sur une période suffisamment longue l’évolution des résultats obtenus par des élèves d’autrefois par rapport aux élèves d’aujourd’hui, n’a été conduite. Tous les problèmes recensés plus haut, font ressortir un déficit de communication à plusieurs niveaux : d’abord, au niveau interne à chaque établissement, ensuite entre les établissements formateurs et aussi entre formateurs et recruteurs et, enfin, entre formateurs, recruteurs et responsables politiques. Ce déficit de communication revient dans les rapports établis par le Comité ad hoc pour la réforme de l’enseignement technique et professionnel au Gabon. A propos de la nécessité d’échanger dans les systèmes de formation des pays en développement, Marc Penouil (1988 : 43-45), fait plusieurs observations. Il pense que pour résoudre les problèmes d’inadaptation de la formation dans les pays en développement, il est souhaitable « de mieux connaître les seuils minimums justifiant, pour chaque secteur, la mise en œuvre d’un système de formation technique ». Pour cela, « un inventaire précis des moyens disponibles, une meilleure définition des objectifs, une plus complète connaissance des contraintes constituent des préalables à toute action efficace, en tenant compte de la spécificité » du pays et de son économie. Mais tous ces aspects interpellent la communication.
LA COMMUNICATION : UN IMPÉRATIF DE PROFESSIONNALITÉ
Mettre de véritables professionnels à disposition du marché de l’emploi, c’est aussi être à l’écoute de ses besoins. Cela nécessite des échanges réguliers entre les responsables pédagogiques (formateurs et politiciens) et les recruteurs.
Le déficit de communication dans les dispositifs actuels
L’observation des dispositifs et des systèmes de formation dans la plupart des États africains (ainsi que les analyses qui précèdent) mettent en évidence le statut actuel de la communication dans les dispositifs de formation mis en place dans la plupart africains, l’Afrique subsaharienne n’est qu’un maillon de cette chaîne : les échanges entre formateurs et recruteurs sont rares et le rapport pédagogique reste un simple rapport de transmission donc de domination. On forme les jeunes sans connaître les attentes des employeurs. De la même manière, plusieurs établissements forment aux mêmes niveaux de qualification, dans les mêmes filières sans se concerter. C’est pourquoi, les opérateurs économiques disent des jeunes qu’ils ne sont pas opérationnels à la sortie de l’école car il y a un décalage entre leur formation et les besoins du poste occupé. Il est donc temps que la communication devienne un impératif dans les systèmes de formation comme cela existe dans la plupart des pays occidentaux, la France en est un exemple.
L’enseignement du cas français
En France, Lionel Jospin, ancien premier Ministre Français (cité par Gramacia, p31), a interpellé les formateurs quant à la nécessité de communiquer dans l’enseignement supérieur : « il nous faut apprendre à vendre le ‘’produit’’ universitaire auprès des entreprises par un effort de communication et de promotion adapté aux besoins des entreprises », a-t-il dit. S’inspirant de cette volonté politique émise par Lionel Jospin, Gino Gramacia (1990 : 31-41) a précisé que « la tradition de méfiance réciproque entre les institutions éducatives et l’industrie appartient désormais à l’histoire. A la suspicion idéologique d’il y a deux décennies, s’est substituée, de part et d’autres, une foi nouvelle dans deux ordres de rationalité : l’économique et le technologique ». Il pense que c’est sans doute dans le domaine de la formation initiale que la coopération est la plus active. Sur le plan institutionnel, des dispositifs existent et qui favorisent la collaboration étroite avec les milieux économiques (commissions professionnelles, pédagogiques, conventions, associations, etc.). Pour lui, les programmes de coopération établissements de formation/entreprises doivent s’ajouter aux stages classiques afin d’adapter les formations aux besoins du tissu économique, c’est pourquoi l’auteur parle de « formations concertées », fondées sur l’échange, la concertation. Or, comme le dit si bien Pierre Naville (1974 : 145), « les échanges, dans un système social quelconque, supposent une communication […] Cette communication peut être purement verbale, voire même réduite à un lien sensoriel aussi ténu qu’un regard ». S’inspirant de la définition de la communication contenue dans le dictionnaire Le Littré15, Naville pense que sans communication, il n’y a pas d’échanges.
CONCLUSION
Après avoir analysé les enjeux de la formation professionnelle pour les pays africains, nous avons ensuite vu, à travers l’analyse de leurs dispositifs actuels (qui intègrent ceux de l’Afrique subsaharienne), que de nombreux efforts restent nécessaires pour faire face à de tels enjeux. Ces efforts seraient vains si individuellement ou collectivement, il n’y avait pas une prise de conscience de l’impératif communicationnel dans la formation des jeunes que l’on veut opérationnels à la sortie des établissements. Il ne faut pas perdre de vue que la distance actuelle observée dans le secteur de la formation professionnelle est à la fois pénalisante pour les formés et pour les économies africaines qui ont souvent recours à une main d’œuvre étrangère (coûteuse) pour combler le déficit de main d’œuvre utile à leurs économies, à défaut d’y avoir recours pour voiler ou combler les lacunes des personnels en exercice. Actuellement, ces dispositifs semblent former les jeunes pour le chômage et non pour le travail, en espérant qu’ils soient formés, plus tard, par le travail. Or, la formation par le travail n’est possible que dans la mesure où le jeune dispose d’assez d’automatismes et d’autonomie pour s’en sortir, seul, devant la complexité de la tâche. En a-t-il seulement les moyens ? Telle est l’ouverture que nous laissons ici, en espérant que les uns et les autres permettront à cette réflexion de porter des fruits qui puissent augurer des lendemains meilleurs pour la formation et le développement durable de l’Afrique.
15 Le Littré dit que la communication est « un envoi réciproque » et que c’est « donner et recevoir ».
BIBLIOGRAPHIE
Jospin L., 1989, Entre universités et entreprises : la communication. Vers un marketing universitaire, Éducation Économie, revue du Haut Comité Éducation Économie, n° 5, avril, mai, juin 1989, cité par Gramacia G., 1990.
Gramacia G., “ Les formations concertées : Écoles/Entreprises ”, p31, Communication et langage n° 85, pp 31-41, 3e trimestre 1990, 127 pages.
Naville. P, 1974, Le nouveau Léviathan 4. Les échanges socialistes, Paris Anthropos, 531 pages. Rapport sur la formation professionnelle dans les pays de la zone de solidarité, adopté le 8 octobre 2001 par le groupe de travail des services de la Primature française, présidé par André Delluc
DETP, 1994, Enseignement technique et secondaire long : constat des forces et des faiblesses. Ministère de l’éducation nationale du Gabon, 6 pages. DETP, 1995, Propositions pour un plan de redressement de l’enseignement technique et professionnel secondaire long, Ministère de l’éducation nationale, Libreville, 43 pages.
Document sur la politique sectorielle de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, élaboré en février 2002 par le Ministère de l’enseignement technique, de la formation professionnelle, de l’alphabétisation et des langues de la République du Sénégal, pp20-23.
Ingénierie de la formation technique et professionnelle : gestion centrale de la formation professionnelle, cahier n°2. Ministère de l’Éducation nationale du Québec, février 2002, 64 pages.
Penouil M., (1988), « Enseignement technique et capital humain ». In cahier du CEMDEV n° 9.
L’avenir des tiers-mondes. Emploi – Formation – Ressources humaines. Paris, 1988, 148 pages.