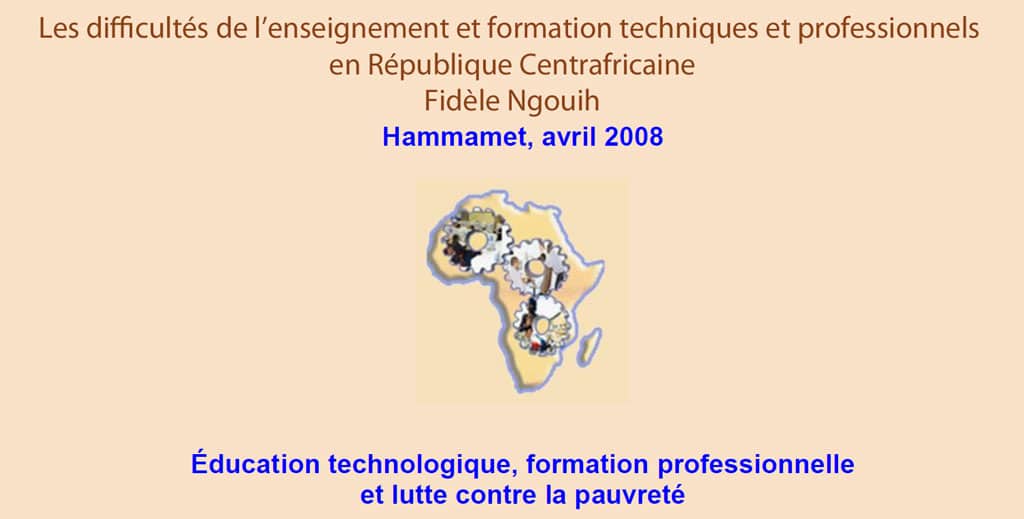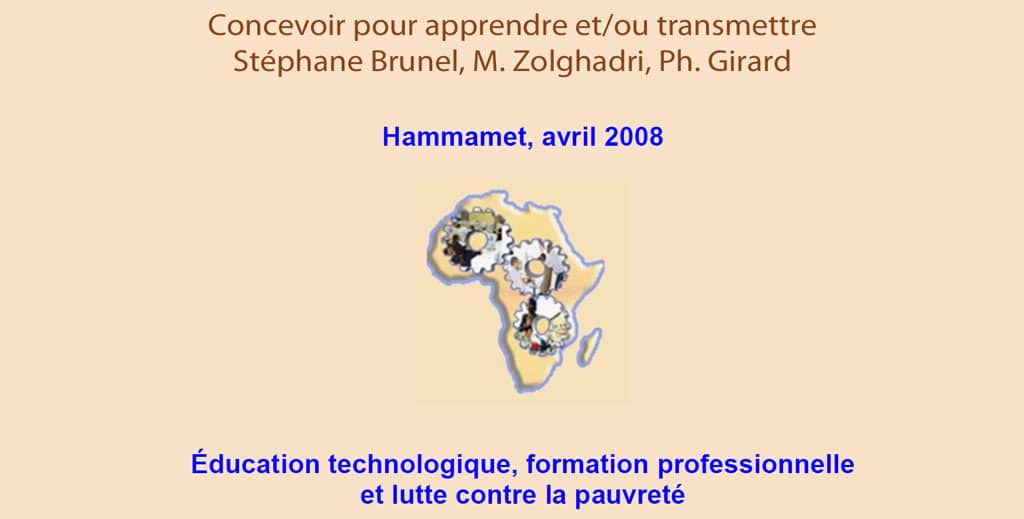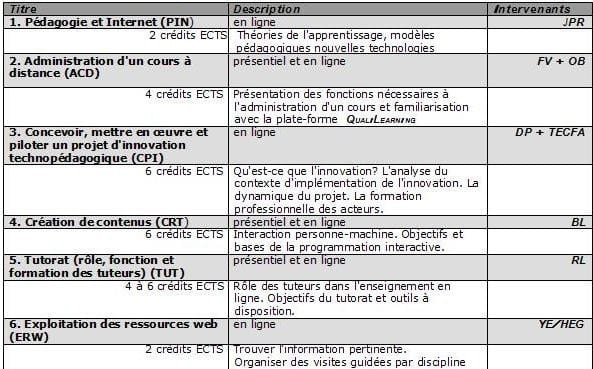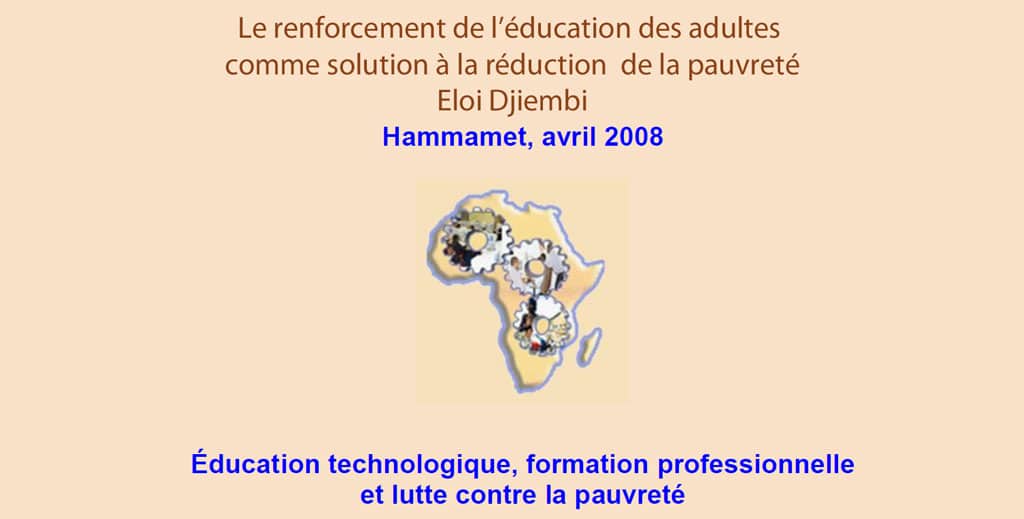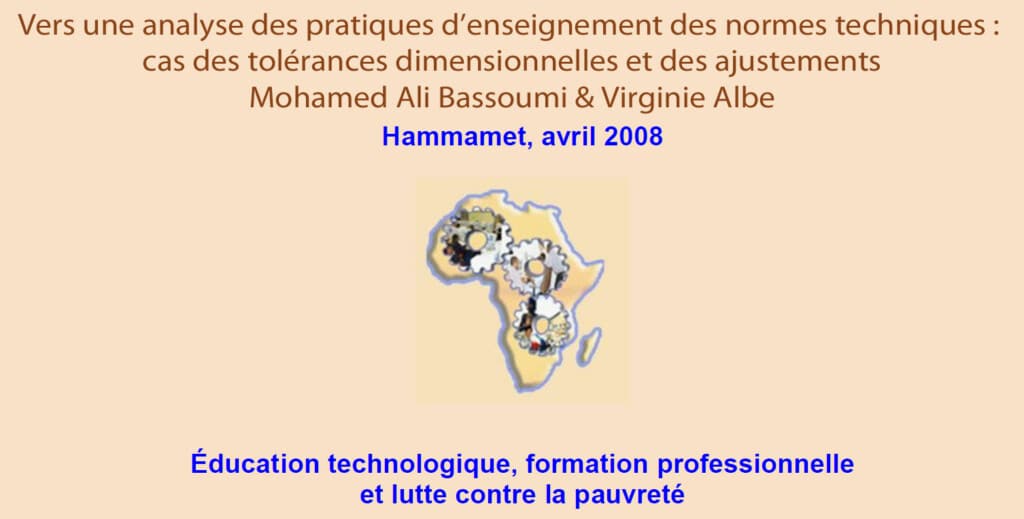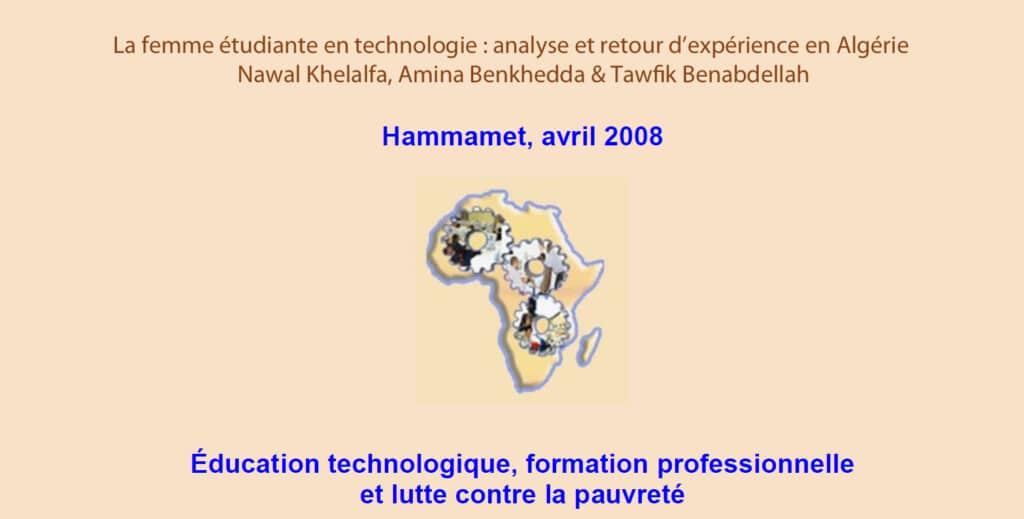Le chef d’établissement aujourd’hui réalités, enjeux et perspectives.
Noël Ngoulo
Summary
In the Central African Republic, there are sixty fifteen (75) public secondary and techniques schools, for more than 83.000 pupils. On the 778 teachers, – including 85 women-, in the high and Middle Schools, the three quarters are former students of the national higher school. In other words, the country counts only one National university which must ensure the initial training of the teachers and to place them at the disposal of the partners’ ministries. In this article, it will be presented realities of the formation, by emphasizing the stakes and the prospects, in comparison with the chief of establishment.
Introduction
La république Centrafricaine compte soixante-quinze (établissements secondaires et techniques publics pour un effectif de plus de quatre vingt trois mille élèves. Sur les 778 enseignants dont 85 femmes dans les lycées et collèges, les trois quarts sont des ressortissants de l’école normale supérieure. En d’autres termes, le pays compte une seule école normale supérieure qui doit assurer la formation initiale des enseignants et les mettre à la disposition des ministères demandeurs. Dans cet article, il s’agira de présenter les réalités de la formation des formateurs en mettant en relief les enjeux et les perspectives, en tant que chef d’établissement.
Réalités de la formation à l’École Normale Supérieure de Bangui
Créée en 1970 par décret n° 70/366 du 07 décembre 1970, l’école normale supérieure est devenue un établissement d’enseignement supérieur de l’université de Bangui par décret n° 82/154 du 04 mars 1982 complété par le décret 87/005 du 12 janvier 1987. La mission confiée à l’école normale supérieure (ENS) est de former : (i) des professeurs du premier cycle secondaire général et technique ; (ii) des professeurs du second cycle secondaire général et technique ; (iii) des professeurs d’école normale des instituteurs ; (iv) des conseillers pédagogiques et (v) des inspecteurs de l’enseignement fondamental. À la demande du gouvernement, d’autres filières peuvent être ouvertes. En attendant l’ouverture d’autres filières, quelle est la situation actuelle ?
L’école normale supérieure de Bangui comprend huit filières et plus de vingt sections :
- filière CAPPC (certificat d’aptitude au professorat du premier cycle). Durée de formation : 3 ans ; sections : lettres modernes, lettres anglaises, histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre, maths-physiques ;
- filière CAPCT (certificat d’aptitude au professorat du collège technique) ; durée de formation : 3 ans ; sections : maçonnerie, mécanique des transports, électricité ;
- filière CAPES (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire) ; durée de formation : 2 ans ; sections : lettres modernes, lettres anglaises, histoire-géographie, philosophie, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques, sciences physiques, mathématiques ;
- filière CAPET (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique) ; durée de formation : 2 ans ; sections : génie civil, génie industriel, génie électrique ;
- filière CAPEA (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement agricole). Durée de formation : 3 ans ; sections : agriculture, foresterie, zootechnique, foresterie, génie rural ;
- filière CAPENI (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement dans les écoles normales d’instituteurs). Durée de formation : 2
- filières IEF (inspecteurs de l’enseignement au fondamental), durée de formation : 2 ans et CP (conseillers Pédagogiques). Durée de formation : 2
Cursus de formation à l’ENS
Schématiquement, comment se présentent les différents cursus de formation ? La figure 1 ci-dessous présente la structure générale des cursus de formation à l’ENS.

Figure 1 structure générale des cursus de formation
Figure 1 : structure générale des cursus de formation
Organisation des enseignements
Les enseignements dispensés à l’ENS se divisent en trois parties : les enseignements en sciences de l’éducation, les enseignements scientifiques de base et les enseignements liés à la culture générale. Pour évaluer les connaissances, deux systèmes sont en vigueur : d’une part, le contrôle continu et, d’autre part, les partiels à la fin de chaque semestre et les examens finaux à la fin du cycle. L’obtention du diplôme du premier cycle est conditionnée par la validation de trois blocs : (i) le bloc théorique, (ii) le bloc pratique et (iii) le bloc mémoire. Pour le diplôme du second cycle, il faut valider deux blocs : (i) le bloc théorique et
(ii) le bloc pratique.
Les stages professionnels : deux types de stages organisent la partie des stages professionnels. Le premier concerne les stages en établissements scolaires qui relèvent du plan pédagogique – stages pédagogiques dans les lycées techniques et dans les collèges d’enseignement technique et général ; stages d’encadrement dans les écoles primaires ; stages pédagogiques dans les ENI – alors que le second type concerne les stages professionnels, qui s’organisent en stages dans les entreprises en première année et en stages d’enseignement au collège ou au lycée technique en deuxième ou troisième année.
Les enjeux de la formation à l’ENS de Bangui
Trois types d’enjeux peuvent être perçus dans la formation à l’École Normale Supérieure : les enjeux politiques, pragmatiques et ontogéniques. À titre de rappel, la mission assignée par le gouvernement à l’ENS est de former les enseignants des collèges et lycées secondaire général et technique. Le tableau suivant met en relief le nombre d’élèves- professeurs et encadreurs formés depuis 2000 à 2006.
| Année | CAPES LM | CAPES LA | CAPES HG | CAPES
Philo |
CAPES SVT | CAPES SP | CAPES
Math |
| 2000-2001 | 15 | 15 | 12 | 01 | 07 | 04 | 04 |
| 2001-2002 | 08 | – | – | 08 | – | 05 | 05 |
| 2002-2003 | 29 | – | 22 | 06 | 08 | 06 | 03 |
| 2003-2004 | – | – | 04 | 06 | 17 | 05 | 04 |
| 2004-2005 | 24 | 15 | 19 | 06 | 09 | 04 | 04 |
| 2005-2006 | – | 22 | – | 09 | 11 | 03 | 10 |
| Total | 76 | 32 | 57 | 36 | 52 | 27 | 30 |
| CAPES SE | BT Sel | CAPPC LA | CAPPC LM | CAPPC HG | CAPPC MP | CAPPC SVT | |
| 2000-2001 | 03 | 15 | 08 | 07 | 06 | 02 | 10 |
| 2001-2002 | 05 | – | 07 | 07 | 10 | – | 05 |
| 2002-2003 | 03 | – | 06 | 30 | 10 | 11 | 06 |
| 2003-2004 | 04 | – | 05 | 09 | 04 | 09 | 08 |
| 2004-2005 | 05 | – | 04 | 21 | 07 | 04 | 07 |
| 2005-2006 | – | – | 16 | 11 | 34 | 07 | 10 |
| Total | 20 | 15 | 46 | 85 | 77 | 33 | 46 |
| CAPEA
Agri |
CAPEA
Foret |
CAPEA
Zoo |
CAPEA GR | CAPET GM | CAPET GI | CAPET
GCiv |
|
| 2000-2001 | 05 | 03 | 03 | – | – | 03 | 04 |
| 2001-2002 | 05 | 03 | 03 | 02 | 01 | – | – |
| 2002-2003 | 06 | 05 | 01 | – | – | – | – |
| 2003-2004 | 05 | – | – | – | – | – | – |
| 2004-2005 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2005-2006 | 02 | 03 | – | – | – | – | – |
| Total | 23 | 14 | 07 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| CAPCT CM | CAPCT MG | CAPCT
Maçon |
CAPCT MTR | CAPCT MEN | CAPCT
Elec |
CAIEF1 | |
| 2000-2001 | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | – |
| 2001-2002 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002-2003 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2003-2004 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004-2005 | – | – | – | – | – | – | 31 |
| 2005-2006 | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 31 |
Tableau 1 : Nombre d’élèves-professeurs ayant terminé leur formation de 2000-2006
Un regard critique sur ce tableau montre qu’il y a peu de vocation dans le domaine scientifique comparativement aux autres domaines. En CAPES sciences physiques par exemple, de 2000 à 2006, 27 personnes ont été formées soit 4 personnes en moyenne par an. Dans le domaine technique, la formation est appuyée par des projets de coopération française. Lorsque le projet arrive à terme, la formation prend fin. Très peu de gens ont été formés pour former dans ce domaine. Même s’il y en avait, l’enseignement ne les intéresse guère. L’enseignement paye peu par rapport à d’autres départements ministériels. L’un des véritables enjeux politiques, c’est que tous les jeunes formés sont intégrés aux comptes gouttes dans la fonction publique centrafricaine. L’État a des problèmes de trésorerie. Conséquences, quelques uns essaient de chercher du travail dans le privé, d’autres font de la vacation dans les collèges et lycées publics, d’autres enfin restent à la maison et l’analphabétisme est vite de retour. D’où la nécessité de ne pas laisser les jeunes formés grossir pendant longtemps le rang de ceux qui sont sortis du système éducatif sans diplôme. Regardons de près la formation à l’école normale supérieure. L’étude des enjeux pragmatiques nous y aidera.
Les enjeux pragmatiques
Dans le domaine de la formation, l’ENS doit relever un défi : celui de former des enseignants de qualité. D’une manière générale, cette formation comprend deux volets. Le premier volet comprend des cours théoriques, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Le second volet qui se déroule sous forme de stage comprend des séries d’actions et d’activités planifiés sur le terrain avec un encadrement assuré d’une part, par des professeurs titulaires dans les lycées et d’autre part par les enseignants de l’ENS pour la partie suivi et évaluation. Il s’agit d’un stage de pleine responsabilité situé en 2e année de formation pour les élèves professeurs des lycées et en 3e année pour ceux qui sont destinés à enseigner au collège. Les élèves professeurs se rendent trois fois dans la semaine sur le terrain. Les élèves conseillers pédagogiques et les élèves inspecteurs du fondamental 1 bénéficient de trois mois de stage dans les écoles primaires de janvier à mars. Ces stages reposent sur les visites de classe et les animations pédagogiques. Il s’agit d’une formation pratique significative et d’une formation professionnelle intégrée. D’où les enjeux pragmatiques de cette formation. Mais le problème c’est que l’ENS souffre d’un certain ombre de carences dans le domaine des formateurs, des infrastructures, des outils pédagogiques et didactiques et dans le domaine des équipements. Développons un seul aspect, celui des formateurs. L’école normale supérieure de Bangui fonctionne grâce à une centaine d‘enseignants. Mais parmi la centaine, nous avons à peine une douzaine d’enseignants permanents. Le reste, ce sont des enseignants vacataires qui viennent des facultés et qui n’ont pas la culture de formation dans les écoles professionnelles. Pour répondre au besoin de formateurs, il faudra envoyer en formation doctorale une quinzaine de collègues enseignants dans les domaines de mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, de pédagogie, de didactique, de psychologie. Nous avons développé l’aspect de l’organisation de la formation à l’ENS en mettant en valeur les difficultés. Mais comment faire pour que ces problèmes soient aplanis ? Essayons d’étudier les enjeux ontogéniques et les perspectives.
Les enjeux ontogéniques et les perspectives
Dans un domaine comme la formation, l’enjeu ontogénique est le fait des enseignants et administrateurs qui veulent perfectionner leurs connaissances, leurs habiletés, ou qui veulent s’épanouir en développant leur établissement. Pour le cas de l’école normale supérieure, quelques pistes de réflexions peuvent être avancées : la recherche, les conditions de recrutement et le système de formation. D’abord, la recherche. Point n’ait besoin de démontrer l’importance et l’intérêt de la recherche. Le problème le plus épineux concernant la recherche est celui des moyens matériels et financiers. En outre, il faut souligner le manque de détermination et de volonté chez les enseignants. L’enseignant au niveau universitaire est appelé à jouer un double rôle : l’enseignement et la recherche. Les difficultés d’ordre psychologique peuvent être surmontées grâce à une prise de conscience du fait que la recherche apporte beaucoup dans la vie professionnelle de l’enseignant. A titre d’exemple, la recherche aboutissant à des publications dans les revues scientifiques permet au chercheur d’être promu à tel ou tel grade selon le corps dans lequel il se trouve. Des travaux de recherche seront soumis à la lecture d’un comité composé de quelques sommités en la matière au niveau interne aussi bien qu’au niveau externe. Entre-temps, sous forme d’atelier, il serait intéressant de faire le point sur l’avancement des travaux aux collègues. Les mémoires des étudiants peuvent faire l’objet d’une compilation susceptible d’être publiée. Ensuite, le recrutement. Dans les domaines scientifique et technique, les vocations sont rares notamment dans les sections mathématiques, sciences physiques, maths-physique, sciences de la vie et de la terre. Or, le vivier est important quand on regarde vers la faculté des sciences et vers les lycées à vocation scientifique et technique. Malgré ce vivier, l’ENS recrute en moyenne six (6) dans ces sections et quatre (4) ou cinq
(5) terminent (cf. le tableau sur le nombre des étudiants qui terminent leurs études à l’ENS). L’une des principales raisons, c’est que le scientifique est mieux payé ailleurs que dans l’enseignement. Pour susciter les vocations, il faut motiver les élèves-professeurs en leur accordant un peu plus de bourse qu’aux autres. C’est le rôle de l’État. Si cette proposition est applicable, les administrateurs de l’ENS doivent battre campagne auprès des futurs candidats dans les lycées en faisant miroiter l’aspect bourse. Enfin, le système de formation. Nous l’avons signalé plus haut, l’ENS fonctionne grâce aux vacataires. Quand on jette un coup d’œil sur les cahiers de texte, on se rend compte que les enseignements sont plus théoriques ; très peu de TP sauf en sciences de la vie et de la terre. Bien qu’il y ait des difficultés d’outils pédagogiques et didactiques, un enseignant doit être animé d’esprit d’initiative, de créativité et surtout planifier les sorties pédagogiques. Notre système de formation est composé d’un bloc important, celui de stage. Si nous voulons améliorer les conditions de formation et valoriser l’enjeu ontogénique, chacun est appelé à prendre ses responsabilités en main. Pour faciliter le stage chez les élèves –professeurs, il serait souhaitable d’accorder systématiquement la bourse à tous ceux qui sont en fin de cycle de formation. Pour les responsables de l’ENS, mettre à leur disposition les moyens logistiques leur permettant de suivre facilement les stagiaires sur le terrain.
Conclusion
Chef d’établissement aujourd’hui, nous avons essayé de montrer dans cet article, à travers les réalités quotidiennes, que les enjeux de formation sont de taille. Ils couvrent les domaines politique, pragmatique et ontogénique. En perspective, l’on devrait prendre conscience que la population centrafricaine s’accroît et que le nombre d’élèves s’accroît également. Il faudrait donc penser non seulement à améliorer les conditions infrastructurelles et les conditions de formation de formateurs, mais en même temps s’ouvrir aux autres pays de la CEMAC dans le cadre du système LMD (licence, maîtrise, doctorat) pour l’harmonisation de la formation.
Résumé
La République Centrafricaine compte soixante-quinze (75) établissements secondaires et techniques publics, pour un effectif de plus de 83 000 élèves. Sur les 778 enseignants, dont 85 femmes, dans les lycées et collèges, les trois quarts sont des anciens élèves de l’école normale supérieure. En d’autres termes, le pays compte une seule école normale supérieure qui doit assurer la formation initiale des enseignants et les mettre à la disposition des ministères commanditaires. Dans cet article, il s’agira de présenter les réalités de la formation en mettant en valeur les enjeux et les perspectives, au regard du chef d’établissement.