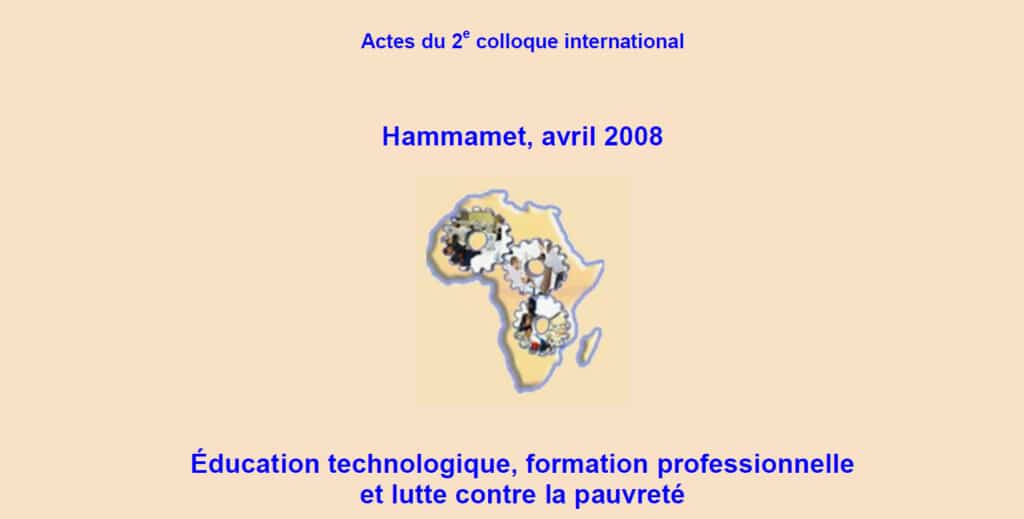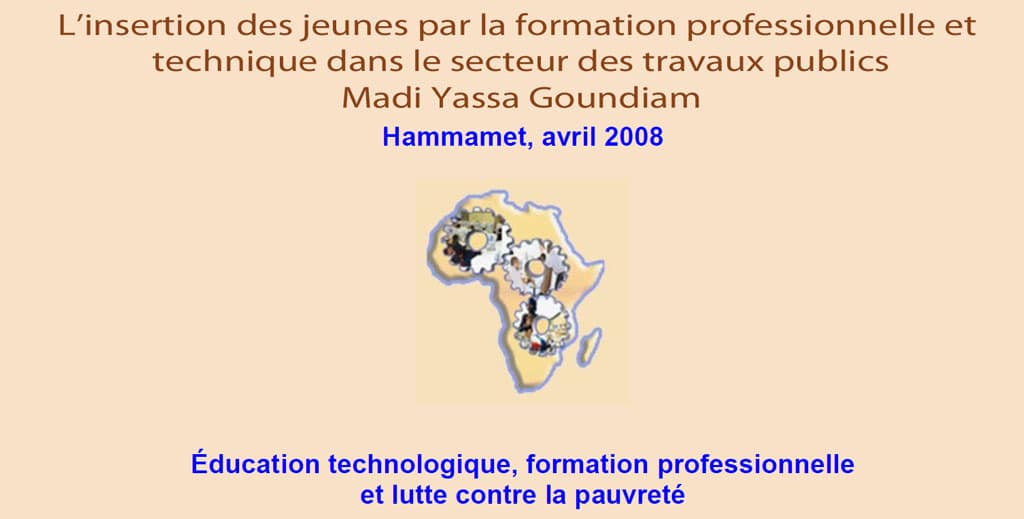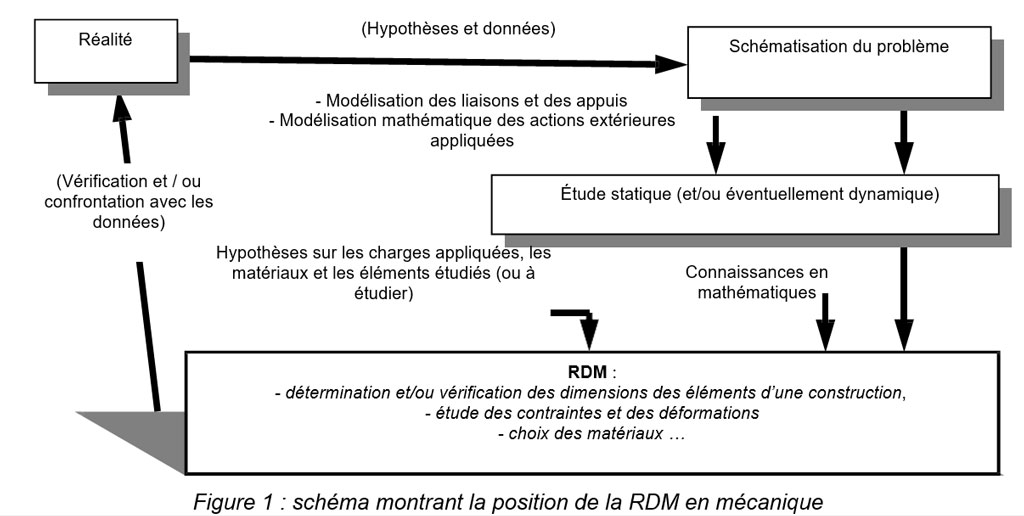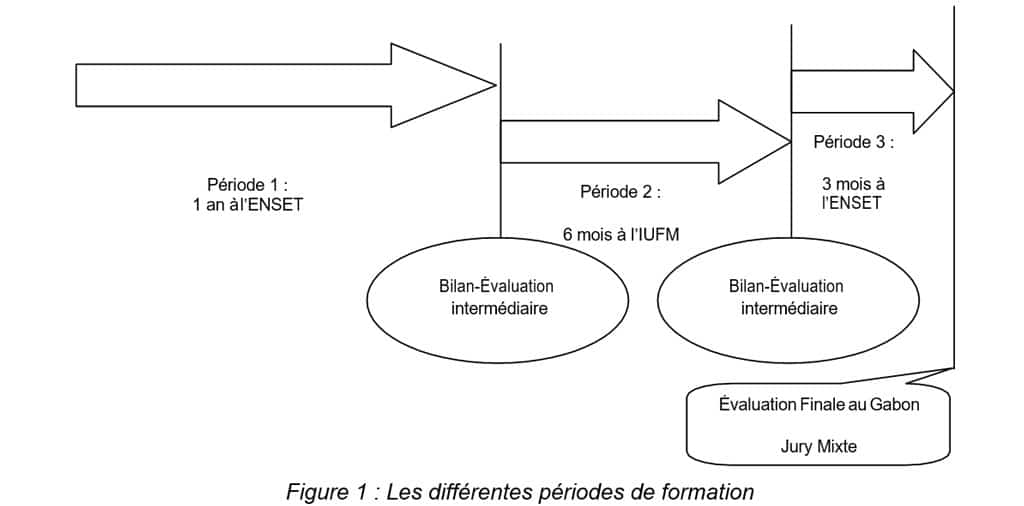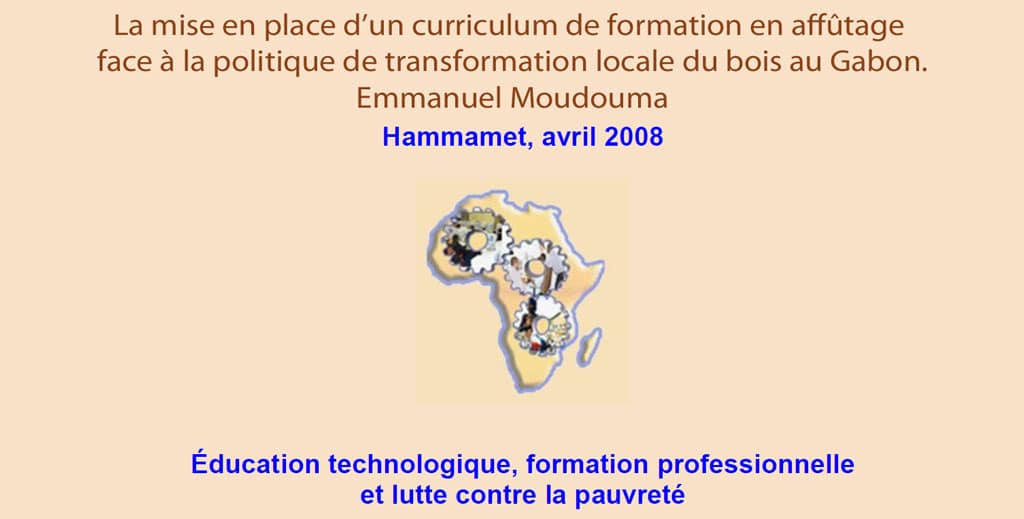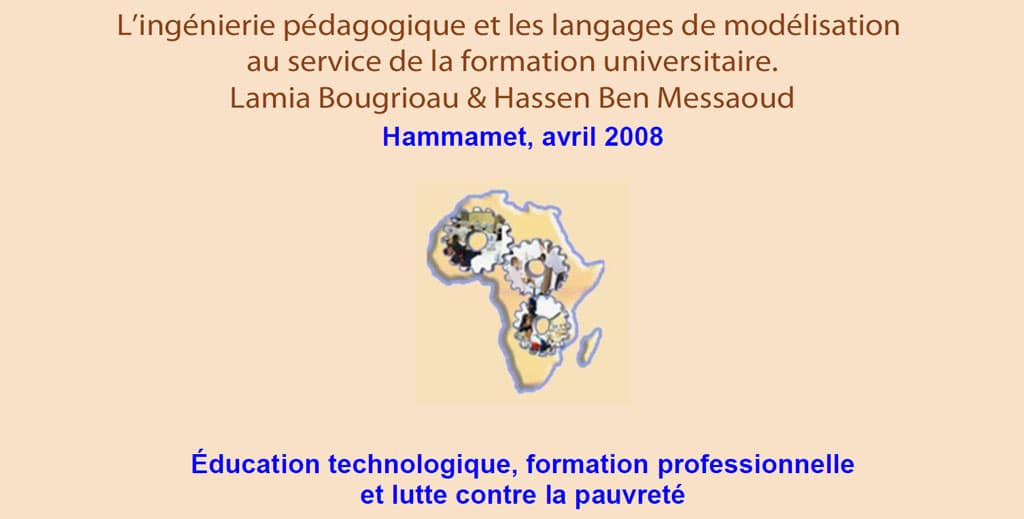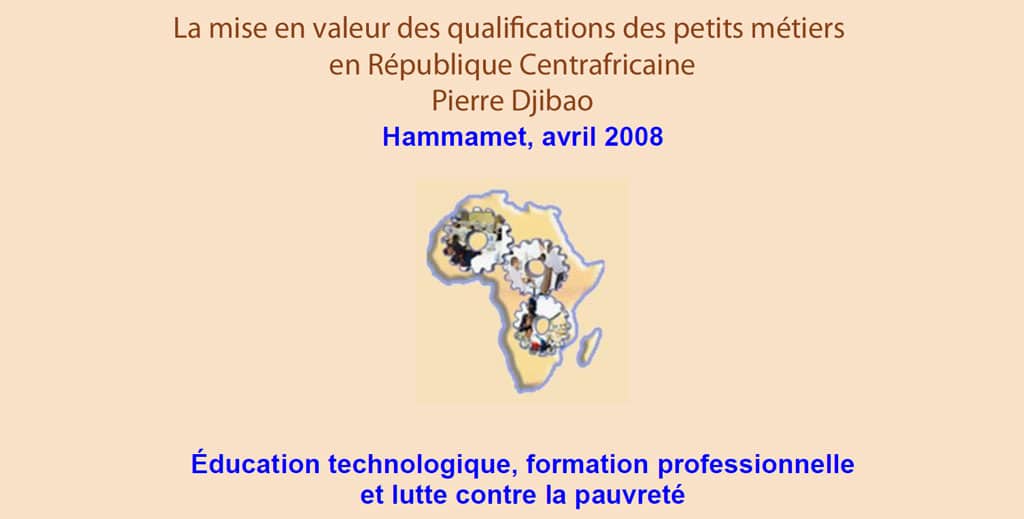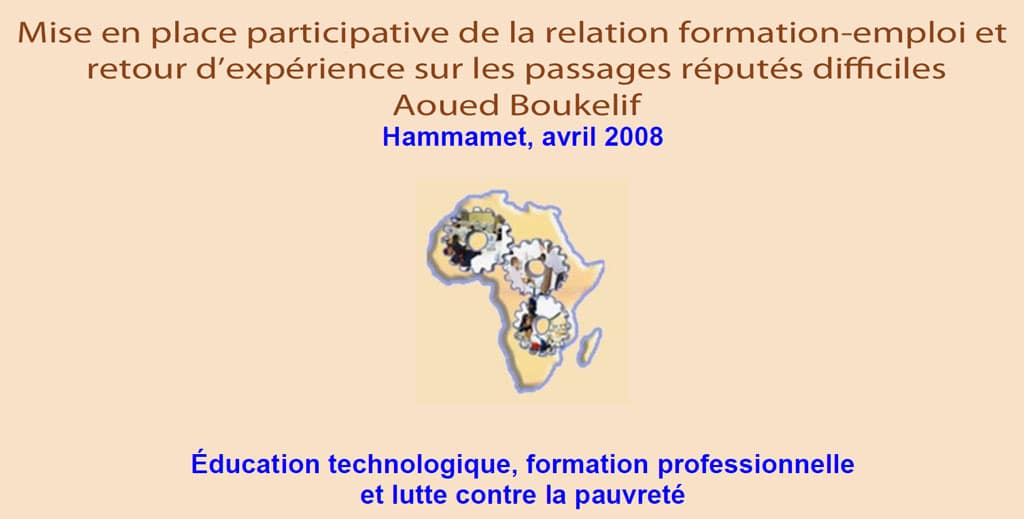Quelle place occupe la simulation, dans la formation des élèves de maintenance automobile de la formation professionnelle au Gabon
Landry Ndoumatseyi Botongoye
Summary
The field of professional didactic, in which we direct our work, has a social aiming for professional training in Gabon. Our work concerns the simulation of the systems, in a world where technology in general, and in particular that related to the trades of the car, is in perpetual evolution. Our research is interested in simulation in the field of professional training in Gabon. It is question for us of asking us how to assemble didactic situations, in order to make effective the trainings of the pupils. We will analyze situations in which the didactic material functions like generator of inferences. This generator rests on the decoding of artefacts, for the implementation of a hardware device, by the articulation of scheme of instrumented actions, and scheme of use. Could the instrumental theory, used here on simulation, be an extensible model with the organization of the situations of teaching in the training of the students of automobile maintenance in Gabon?
Keywords: simulators, instrumental theory, decoding of artefacts, materials didactic, instrumented actions.
Introduction
L’enseignement de la maintenance automobile repose principalement sur l’étude des objets techniques industriels. Ces activités ont pour visée de permettre aux élèves d’acquérir, sous forme expérimentale, des savoirs et des savoir-faire sur des systèmes automatisés. Des auteurs tels que Samurçay et Rogalski (1998), Leplat (1997), ou encore Béguin et Weill- Fassina (1997) nous permettent à travers leurs écrits, de mesurer l’impact de la simulation dans le domaine de la formation. Il est évident que pour former un technicien à la résolution des problèmes (Patrick, 1992, 1993 ; Allen, Hayes & Buffardi, 1986 ; Shepherd, Marshall, Turner & Duncan, 1977), la manipulation directe de l’équipement réel est souvent souhaitable. Cependant, il peut s’avérer difficile, voir techniquement impossible de disposer des équipements réels pour des besoins de formation (l’une des nombreuses raisons évoquées reste le coût du matériel ou encore les différents problèmes de sécurité qui s’y rattachent).
L’histoire de l’automobile est marquée par l’influence croissante de l’électronique et de la technologie de l’ordinateur. Cette évolution technologique, exige des techniciens, une adaptation permanente face à ces nouvelles technologies. Aussi, les véhicules devenant de plus en plus perfectionnés et donc inappropriés pour le milieu scolaire. Dans cette perspective, le monde scolaire a recours aux supports didactiques variés tels les simulateurs, les maquettes et autres supports destinés à familiariser les élèves avec de vrais systèmes ou de vraies situations d’activités, similaires à celles du domaine professionnel.
Référents théoriques
Ce travail s’inscrit dans le champ de la théorie de l’activité ; théorie où l’instrument joue un rôle central dans le développement des compétences des opérateurs. La théorie de l’activité s’inspirent des travaux de Vygotski (1978) ; Luria (1979) ; Ochanine (1966) et Leontiev (1974). Pour le dernier cité, derrière l’objet se cache un désir auquel répond l’activité et que les processus engagé dans l’activité sont conscients car guidés par l’objet. L’activité est composée d’un sujet, d’un objet (but, objectif ou finalité qui oriente l’activité), d’actions et d’opérations. La théorie de l’activité met en valeur le rôle médiateur des artefacts (le langage, les outils, les machines, etc.) qui organisent les fonctions supérieures et permettent de contrôler l’action. La médiation des artefacts est considérée comme moteur de développement des compétences notamment celle de la zone proximale de développement soutenue par Vygotski et qui permet de caractériser les médiateurs du point de vue de leur caractère facilitateur dans le processus de développement.
Contexte et enjeux
Ce travail se situe entre deux approches de recherche, celle de la didactique professionnelle et celle de l’anthropologie ou dirons nous, celle de la psychologie dans des situations d’utilisation d’outils, d’instruments de communication et de représentations techniques. Cependant, comme le mentionne Vergnaud (1994), dans le domaine des enseignements techniques, professionnels et technologiques, cette approche par la psychologie des processus cognitifs de l’élève (représentation, apprentissage, etc.) est nettement moins développée comparée aux disciplines scientifiques et mathématiques. C’est en ce sens que Andreucci, Froment & Verillon (1996) évoquent, le statut social particulier de la technique dans le monde scolaire, le caractère récent et peu massif de l’investigation de ce champ par la didactique et le statut épistémologique complexe des savoirs techniques.
L’approche anthropologique reconnaît le rôle fondamental joué par l’instrument en tant qu’outil de médiation dans les rapports qu’entretient le sujet avec son milieu. Notre travail cherche à renforcer la dimension expérimentale des enseignements par la mise en place des travaux pratiques et technologiques. Ce travail a à cœur, de justifier l’usage du matériel en référence à des pratiques externes à l’école. Pour certains, la machine comme support didactique, n’intervient pas directement dans le processus d’apprentissage (voire elle serait un obstacle à l’apprentissage) et pour d’autres, elle permet de contextualiser des situations et devient un prétexte à d’autres apprentissages. La conception dominante des simulateurs les représente comme une reproduction imitée des systèmes existants, représentations qui pourtant, doit garder les fonctions et les fonctionnalités de l’objet-référent. Ceci, au risque de voir l’utilisation des machines devenir très vite artificielle, et sans problème particulier à résoudre si ce n’est de les mettre en œuvre par le biais de descriptions procédurales et sans enjeux concrets de savoirs.
Questionnement et hypothèses
Les simulateurs comme systèmes représentatifs doivent, non seulement intégrer un ensemble de formes mais aussi un ensemble de fonctions de l’objet-modèle. L’exigence de formalisation de ce qui va être fait et comment cela devrait être fait lors de la phase de réalisation de l’activité repose en partie pour les opérateurs, sur le déchiffrage et le décodage corrects des représentations graphiques qui accompagnent le simulateur. Il y a de fait, une forte relation d’assujettissement au matériel mis en œuvre dans la situation avec la situation elle-même. Autrement dit, ce n’est pas le matériel mis en œuvre ou la qualité des injonctions pédagogiques de l’enseignant qui sont garantes de l’apprentissage d’un savoir par les élèves mais la situation mise en place dans la richesse des interactions qu’elle permet. Ceci constitue les termes d’un système dynamique qui met en relation des acteurs de la situation didactique (élèves, enseignants, outils et objets d’enseignement). Il s’agit d’analyser des situations dans lesquelles le matériel didactique fourni, fonctionne comme générateur d’inférences.
Ce générateur repose sur le décodage d’artefacts pour la mise en œuvre d’un dispositif matériel par l’articulation de schèmes d’actions instrumentées et de schèmes d’usage. Le travail que nous présentons est en cours d’élaboration. Il prend appui sur nos travaux de maîtrise (Ndoumatseyi Botongoye, 2005) et de master recherche (Ndoumatseyi Botongoye, 2006). Notre travail devrait permettre de penser le rôle du matériel didactique dans les enseignements professionnels, notamment du point de vue de leur incidence sur les processus d’enseignement-apprentissage. Nous savons également que la démarche de simulation permet, à partir des besoins pédagogiques, d’imaginer d’une part comment l’outil didactique peut fournir une réponse pertinente à ces besoins, puis d’autre part, de s’attaquer aux problèmes de mise en œuvre de matériel afin d’apporter des réponses spécifiques aux problèmes posés. Dans notre cas, il s’agira de regarder comment les enseignants organisent la formation des élèves et comment ces derniers apprennent.
Médiation des situations didactiques
La relation didactique
Dans une situation didactique, l’enjeu est le savoir et plusieurs liens unissent les différents acteurs. L’élève et le savoir sont liés par l’apprentissage et l’acquisition. L’enseignant et les élèves sont liés par le processus de formation/le contrat didactique. L’enseignant et le savoir sont liés par la transposition didactique. Cette relation triangulaire ramenée au domaine de la maintenance automobile, peut se schématiser de la façon suivante :

Figure 1 Triangle didactique rapporté aux métiers de l’automobile.
Figure 1 : Triangle didactique rapporté aux métiers de l’automobile.
Les activités proposées prennent appui sur des situations issues du domaine de la maintenance automobiles. Les différentes activités confiées aux élèves recouvrent de facto, un double jeu ; celui de leur permettre de réaliser une activité professionnelle et celui d’accroître leurs connaissances, développer chez eux des compétences. Le but dans ces activités est de permettre aux élèves d’effectuer des interventions dites de préparation, sur des systèmes, modèles de ceux auxquels ils seront confrontés en tant qu’acteurs professionnels.
L’enseignant, un acteur-régulateur
L’enseignant comme autre acteur de la situation didactique, reste présent, fût ce en arrière plan de l’activité des élèves. Son rôle demeure le plus déterminant dans la progression du travail confié aux élèves. Il organise la rencontre de l’élève avec le système et s’en détache ; c’est le guide didactique. Il réalise la rencontre de l’élève avec le milieu didactique, dans le but de lui faire atteindre le savoir. C’est le principal arbitre vers qui les élèves se tournent pour obtenir des informations supplémentaires et nécessaires pour la progression de leur activité.

Figure 2 Médiation par l’enseignant
Pour Samurçay et Rabardel (2003), les médiations ne sont qu’exceptionnellement supportées par les seuls systèmes ; des hommes y assurent également le statut de médiateurs. Ce sont, bien évidemment les enseignants, mais aussi de façon très générale les autres élèves dans une classe, également les autres acteurs d’une même communauté de pratique, etc.). L’enseignant intervient comme médiateur entre d’une part le couple élève- système modèle (situation didactique d’apprentissage) et d’autre part celui élève-système référent (situation didactique de transfert). C’est également l’acteur de la construction de la situation de formation, dans la relation triangulaire qui le lie au modèle et au système- référent (transposition didactique). Il acquiert un statut particulier, qui fait de lui, un sujet- régulateur dans la situation didactique.
Médiations par les systèmes (système-simulé et système-référent)
Les rapports entre sujet-opérant, système-modèle et système référent, renvoie au codage auquel fait face celui-ci. L’enjeu est celui de la construction par l’opérateur (élève) de descripteurs pertinents du système-référent. Verillon (1996) définit les descripteurs comme l’ensemble des variables qui permettent de décrire l’objet référent dans des catégories de langages cohérents avec la logique de la classe de tâches, c’est à dire en fonction des besoins d’information des opérateurs pour réaliser leur tâche. Pour une activité de diagnostic en maintenance automobile par exemple, le simulateur en tant qu’instrument est un médiateur qui permet de développer chez l’élève des compétences et des connaissances. Par cette médiation, le simulateur sera considéré comme générateur d’activité. C’est à travers ce système que les élèves apprendront de façon générale le métier, par la compréhension du système et l’appréhension de certaines méthodes et procédures de travail. Le schéma ci-dessous, montre le type de rapport qui lit le simulateur aux autres composants de la situation de didactique :

Figure 3 Médiation par le système-modèle
Figure 3 : Médiation par le système-modèle
L’élève passe par le système simulé pour apprendre le métier et acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur le système-référent. Le système simulé est un moyen d’accès au système-référent. Agir directement sur un système réel, nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs tels la difficulté d’appréhender certains phénomènes, etc. Le système modèle est à la fois un instrument, un outil pour les opérateurs (enseignant et élèves).
Quelle représentation les élèves ont de ces systèmes
Dans le domaine de l’automobile, les différents systèmes-modèles rencontrés, sont souvent des systèmes mixtes, composés de diverses représentations techniques. Ces systèmes possèdent à la fois des éléments analogiques et symboliques. On retrouve en effet sur ces systèmes, des objets, sous forme de graphismes techniques et de symboles codifiés (voir ci-après).
 Figure 4 : Simulateur du système de freinage |
 Figure 5 : Simulateur des feux de signalisation visuelle |
| Figure 4 : Simulateur du système de freinage | Figure 5 : Simulateur des feux de signalisation visuelle |
Pour certains élèves, il n’est pas toujours facile de faire le lien entre ces représentations graphiques et les éléments du système-référent. D’où leur refus d’accepter ces représentations comme éléments renvoyant aux objets réels. Il est clair que l’élaboration des descripteurs pertinents n’est pas toujours évidente pour les élèves. Il y a assurément, conflit de code du fait que les élèves ne sachent pas déchiffrer ou lire l’artefact sur lequel ils travaillent. Le véritable problème des élèves se trouve lié à la transférabilité des compétences lié au manque de maîtrise de la codification qui accompagne ces systèmes. Il est pour eux, difficile d’exporter ce savoir vers des situations réelles. C’est pourquoi, certains disent ne pas aimer l’utilisation des supports théoriques (maquettes, simulateurs, supports de technologie). Il faut d’une part pour les élèves, acquérir un langage cohérant lui permettant de communiquer avec le système et d’autre part connaître le lien qui existe entre les éléments du système, pour pouvoir les représenter correctement sur le réel. Également, connaître le langage technique adéquat leur permettant de communiquer avec le système sur lequel ils interviennent. Les futurs techniciens doivent posséder une maîtrise des différentes représentations techniques en rapport avec leur domaine de compétences ; maîtrise capable d’engendrer des solutions nouvelles à des problèmes spécifiques. L’acquisition par les élèves d’une représentation cohérente des codes et d’une transposition des propriétés fonctionnelles des représentations graphiques, facilitera l’interprétation des paramètres qu’ils devront décrypter.
Discussion
Cette recherche permet d’aborder les quelques problèmes posés par l’apprentissage d’un objet de savoir dans les métiers de la maintenance automobile, avec pour supports d’apprentissage et de formation, les simulateurs de façon particulière et de façon générale tous les outils didactiques modèles qui accompagnent l’enseignant dans l’organisation des différentes situations d’enseignement-apprentissage. La médiation par les instruments est de façon générale, au cœur de l’activité de l’homme. Dans les formations techniques et professionnelles, il est fait usage de supports d’un certain type, supports qui servent d’intermédiaires et qui permettent au sujet une certaine familiarité avec les différents référents. Comme nous l’avons mentionné, ces instruments d’un type particulier se présentent sous forme composée (graphismes et autres représentations techniques). Ces instruments exigent de la part des opérateurs, un décodage et donc, des connaissances particulières pour pouvoir les appréhender et faciliter leur manipulation. Il s’avère cependant que le déchiffrage de ces codes ou encore la maîtrise du langage technique qui permet de comprendre ces systèmes n’est pas souvent facile d’accès ; ce qui pose souvent un problème d’interprétation. Pourtant, l’intention dans l’utilisation de ces instruments n’est pas que ces outils soient des obstacles aux apprentissages pour les élèves ou pire encore, un obstacle aux enseignements pour les formateurs (le manque de maîtrise de ces outils de la part des enseignants peut occasionner cette situation). Les graphismes techniques, les schématisations et de façon générale les simulateurs (dans notre cas), semblent être des aides à l’enseignement et à l’apprentissage respectivement, pour les enseignants et les élèves Vezin (1972 ; 1984). Il est donc évident que les activités qui prennent pour supports des outils matériels et sémiotiques paraissent indispensables et difficilement contournables dans les formations techniques et professionnelles. Cependant, avec recul, l’utilisation de ces outils dans ces formations techniques et professionnelles suffit elle à assurer leur légitimité dans la formation des techniciens de l’automobile dans le contexte gabonais ? Ou encore, l’utilisation de ses systèmes répond t’elle à une logique de raisonnement, de besoin ou à celle d’une stratégie pédagogique précise ?
Bibliographie
Allen, J. A., Hayes, R. T. & Buffardi, L. C. (1986). Maintenance training simulator fidelity and individual differences in transfer of training. human factor, n° 28, pp. 497-509
Andreucci, C., Froment, J-P., Verillon, P. (1996) Contribution à l’analyse des situations d’enseignement/ apprentissage d’instruments sémiotiques de communication technique. In Aster n° 23, Recherche en didactique des sciences expérimentales : enseignement de la technologie. ISSN 0297-9373, INRP
Beguin, P. & Weill-Fassina, A. (Éd) (1997). La simulation en ergonomie : Connaitre, réagir, interagir.
Toulouse : éditions Octarès
Léontiev, A. (1974). The problem of activity in psychology. Soviet psychology, n° 13, 14-33.
Leplat, J. (1997). Regards sur l’activité en situation de travail. (Chapitre 8 : simulation et simulateur : principes et usages). Paris, PUF
Luria, A. R. (1979). The making of mind: a personal account of soviet psychology. Cambridge, MA : Harvard University Press.
Ndoumatseyi Botongoye, L. (2005). simulateur comme support d’apprentissage du système de conditionnement d’air en maintenance des véhicules automobiles. Mémoire de Maîtrise, Sciences de l’Éducation. Université de Provence.
Ndoumatseyi Botongoye, L. (2006). Le problème des descripteurs du dispositif simulé, en formation mobilisant les simulateurs. Cas d’une formation préparant à l’activité de diagnostic en maintenance des véhicules automobiles. Mémoire de master recherche, sciences de l’éducation. université de Provence, Aix-Marseille I.
Ochanine, D. A. (1966). The operative image of a controlled object in man-automatic machine systems. XVIIIth International Congress of Psychology, Symposium 27, Theoretical problems of man- machine systems, Moscow.
Patrick, J. (1992). Training: research and practice, academic press limited.
Patrick, J. (1993). Cognitive aspects of fault-finding. Training and transfer. Le Travail Humain, n° 56, pp.
187-209
Samurçay, R., Rogalski, J. (1998). Exploitation didactique des situations de simulation. Le travail humain, n° 61, 4, pp.333-360.
Samurçay, R. & Rabardel, P. (2003). De l’apprentissage par les artefacts à l’apprentissage médiatisé par les instruments. In Vergnaud G. (Ed.) Actes du colloque Compétences complexes dans l’éducation et le travail. Cédérom.
Shepherd, A., Marshall, E. C., Turner, A., Duncan, K. (1977). Diagnostic and plant failures from a control panel: a comparison of three training methods. Ergonomics, n° 20, pp. 347-361
Vergnaud, G. (1994). Apprentissages et didactiques. Où en est-on ? Hachette
Verillon, P. (1996). A problematica do instrument : um cuadro para reflexao do ensino do grafismo (La problématique de l’instrument : un cadre pour penser l’enseignement du graphisme). Graf & Tec, n°0, pp. 57-78.
Vezin, J-F. (1972). L’apprentissage des schémas, leur rôle dans l’assimilation des connaissances.
L’année psychologique, pp. 179-198
Vezin, J-F. (1984). L’apport de l’informationnel des schémas dans l’apprentissage, Le Travail humain, n° 47, 1 pp. 61-74
Vygotski, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes. Harvard University Press, Cambridge MA.
Résumé
Le champ de la didactique professionnelle, dans lequel nous orientons notre travail, a une visée sociale pour la formation professionnelle au Gabon. Notre travail porte sur la simulation des systèmes, dans un monde où la technologie en général, et en particulier celle liée aux métiers de l’automobile, est en perpétuelle évolution. Notre recherche s’intéresse à la simulation dans le domaine de la formation professionnelle au Gabon. Il est question pour nous de nous demander comment monter des situations didactiques, afin de rendre efficace les apprentissages des élèves. Nous analyserons des situations dans lesquelles le matériel didactique fonctionne comme générateur d’inférences. Ce générateur repose sur le décodage d’artefacts, pour la mise en œuvre d’un dispositif matériel, par l’articulation de schèmes d’actions instrumentées et de schèmes d’usage. Est-ce que la théorie instrumentale, utilisée ici sur la simulation, pourrait être un modèle extensible à l’organisation des situations d’enseignement dans la formation des étudiants de maintenance automobile au Gabon ?
Mots-clés : simulateurs, théorie instrumentale, décodage d’artefacts, matériels didactiques, actions instrumentées.